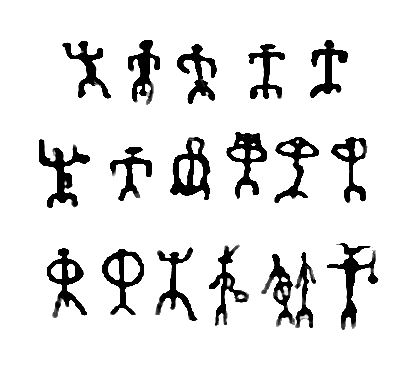CINEMA EXPERIMENTAL ET NUMERISATION
(Alain Montesse, Pip Chodorov, Benoît Labourdette, Dominique
Willoughby, Michel Lefebvre et al.)
Le présent texte est le condensé, certes lourdement
compressé, de trois visioconférences émises les 15/2/2006,
15/5/2007 et 8/4/2008 depuis la régie de l'université Paris-7
Denis-Diderot, dans le cadre de l'association Carrefours Télématiques
. On a essayé de faire en sorte que la compression soit la moins
destructive possible.
Les visioconférences étaient
visibles sur le site de Paris-7 Denis-Diderot, mais à peine la
responsable Marie-Claide Vettraino-Soulard avait-elle pris sa retraite que, dans
sa grande sagesse, le service informatique de l'université a effacé
tout le site de l'association, ainsi que le site du séminaire associé
Ecrit, Image, Oral et Nouvelles Technologies. On peut en retrouver des morceaux
sur archive.org, en demandant les adresses
http://www.artemis.jussieu.fr/ct/ et
http://www.artemis.jussieu.fr/hermes/ .
D'anciens
membres du groupe ont à peu près rétabli les sites en
question, aux adresses http://www.visiotice.fr/ARTEMIS/CT/
et http://www.visiotice.fr/ARTEMIS/hermes/.
Les
visioconférences sont directement téléchargeables en
http://alain.montesse.free.fr/kinumexp/ct060215.rm,
http://alain.montesse.free.fr/kinumexp/ct070515.rm
et http://alain.montesse.free.fr/kinumexp/ct080408.rm.
1.1.- Intervention d'Alain Montesse
Alain Montesse.- La question de la numérisation du cinéma
est à l'ordre du jour. Cette question a des aspects techniques,
industriels, esthétiques, phynanciers, juridiques, patrimoniaux, etc.,
assez inextricablement liés ; la numérisation présente des
intérêts évidents, elle a aussi quelques inconvénients
pas du tout négligeables.
Parmi les différentes catégorie de films, il en est une qui
pose d'un seul coup tous les problèmes, plus quelques autres bien spécifiques
: le cinéma expérimenta
Mais qu'est-ce que le cinéma expérimental ? On en trouvera
autant de définitions que d'écoles et de périodes
historiques, ce qui n'est pas peu dire. Les tout premiers films étaient évidemment
expérimentaux, puisqu'on n'avait jamais rien fait de tel auparavant.
Ensuite, la liste est longue des films qui ont fait apparaître (ou résonner...)
quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant, qui ont fait vivre au
spectateur des expériences nouvelles. De L'assassinat du Duc de
Guise, si l'on veut, en passant par les films de la révolution russe
(Vertov etL'Homme à la caméra, , Koulechov et son effet,
Eisenstein de temps en temps...), les films dada et surréalistes, le cinémaundergrou
(principalement anglo-saxon, mais pas seulement) des années 60 et
70, les films lettristes et situationnistes, nombre de films d'animation,
certaines pubs et clips vidéo... et jusqu'au premier Matri
1 .
Donc, cela concerne aussi bien sûr le cinéma scientifique, où
il s'agit de mettre en scène des expériences, d'enregistrer le déroulement
d'un processus ou d'une expérience pour analyse ultérieure (caméras
filmant le décollage d'une fusée et son éventuel
dysfontionnement, ralentissement ou accélération image par
image...) ; et aussi bien sûr le cinéma ethnographique.
En bref, je considère comme cinéma expérimental tout
ce qui consiste à mener des expériences au moyen du cinéma,
en poussant les différentes techniques à leurs limites -
techniques au sens large, jusques et y-compris aux techniques de manipulation
du spectateur.. Debord rappelle dans In girum imus nocte et consumimur igni
que le cinéma aurait pu être tout autre chose que ce qu'il est
"Les anecdotes représentées sont les pierres dont était
bâti tout l'édifice du cinéma. On n'y retrouve rien d'autre
que les vieux personnages du théâtre, mais sur une scène
plus spacieuse et plus mobile, ou du roman, mais dans des vêtements et
environnements plus directement sensibles. C'est une société, et
non une technique, qui a fait le cinéma ainsi. Il aurait pu être
examen historique, théorie, essai, mémoires. Il aurait pu être
le film que je fais en ce moment."
Il serait trop long de tenter de résumer ici l'histoire du cinéma
expérimental. On en trouvera diverses présentations sur
l'internet 2 . Notons que ce cinéma
ne s'inscrit pas seulement dans des problématiques esthétiques :
l'un des facteurs déclenchants du meurtre de Théo Van Gogh fin
2004 a été son film Soumission&nbs; 3 ; les anciens membres de la
Filmkooperative de Hamburg ont composé un film retraçant
l'histoire de leur groupe 4 , où
les composantes politiques ou sociétales sont bien exposées. Il y
eut de nombreuses relations, pas toujours harmonieuses, entre cinéastes
expérimentaux et cinéastes militant
Je considère que le langage (?) du cinéma expérimental
est le langage du cinéma dans toute sa généralité.
Le cinéma au sens habituel du terme n'est qu'un cinéma
particulier, et pas l'inverse.
L'idée la plus simple pour numériser un film semblerait être
de mettre une caméra numérique en face d'un projecteur cinéma,
avec éventuellement un écran ou un dépoli entre les deux,
et de faire tourner. En fait, ce n'est pas si simple. Considérons par
exemple l'installation du CERIS en Basse-Normandie (
http://www.ceris-normandie.com/leceris.php?intra=3#bas
), qui figure parmi ce que j'ai vu de mieux en matière de structures
associatives, non industrielles de conservation du patrimoine audiovisuel en région.
Le projecteur est interchangeable selon le format du film. Le système
optique entre le projecteur et la caméra a été construit
par Alain Hairie, physicien, ingénieur au SIFCOM (laboratoire "Structure
des Interfaces et Fonctionnalité des Couches Minces", qui est une
UMR du CNRS et de l'ENSICAEN liée par convention à l'Université
de Caen). Le miroir est un miroir teinté spécial. La
synchronisation est manuelle (à propos du réglage de la vitesse
d'obturation, voir par exemple
http://www.lunerouge.org/spip/article.php3?id_article=137
). Le choix de la caméra est crucial, et il y faut en plus le
savoir-faire et la dextérité de l'opérateur. Le film une
fois numérisé est stocké sur DV-cam ; l'original est également
archivé. Enfin, la diffusion se fait par le biais d'expositions, par la
vente de DVDs dans le commerce.
On le pressent, la numérisation d'un film n'est pas un acte simple,
pour lequel il suffirait d'appuyer sur le bouton. C'est toute une chaîne
d'opérations et de décisions, pas seulement techniques.
Les différentes questions que l'on peut se poser à propos des
relations entre cinéma expérimental et numérisation
peuvent être rassemblées en quelques grandes catégories,
distinctes, mais pas complètement indépendantes
- A.- sauvegarde, restauration et archivage
- A.1- technique de numérisation
- A.2- Définition
- A.3- entrelacement
- A.4- vitesse
- A.5- étalonnage
- A.6- restauration
- A.7- compression
- A.8- archivage et stockage
- B.- diffusion
- C.- création
A.- Sauvegarde, restauration et archivage
A.1- Technique de numérisation
Il y a plusieurs techniques de numérisation, relevant de deux procédures
distinctes : le télécinéma et le scan 5 .
Le télécinéma a précédé le magnétoscope
dans l'histoire de la télévision : il permettait de diffuser
à l'antenne les films cinématographiques, en transformant dans le
temps même du défilement (peut-on appeler cela du temps réel
?) l'image photochimique en signaux électriques envoyés
directement à l'antenne. C'est donc un projecteur de cinéma débitant
dans des circuits électroniques. Plus tard, on y adjoignit un magnétoscope,
ce qui permit l'enregistrement des films sur bande magnétique. Pendant
très longtemps, et même encore de nos jours, on a dû se
contenter d'images entrelacées (cf. ci-dessous). Ce n'est que depuis
quelques années qu'on commence à voir apparaître des télécinémas
"progressifs", et même, tout récemment, "Haute Définition"
(cf. ci-dessous).
Le scanner est d'apparition beaucoup plus récente. Son principe
consiste à transformer, image par image, chaque image du film en un
fichier informatique. Jusqu'à récemment, le processus ne
s'effectuait donc pas à la vitesse de défilement du film, mais à
un rythme nettement plus faible, de l'ordre quelques images par seconde au
mieux (il faut le temps de scanner l'image, de la transférer sur disque
dur, puis de passer à la suivante, et ainsi de suite). Après les
premières machines construites par les utilisateurs eux-mêmes dans
les firmes d'effets spéciaux, on vit apparaître les premières
machines dédiées, le Domino de Quantel en 1993, puis le Spirit de
Philips-Thomson-Tektronics en 1998 6
. Ces machines sont presque de la taille d'une armoire normande, sans
compter leurs périphériques, et sont surtout fort chère
Depuis le début des années 2000, on voit timidement apparaître
des systèmes légers, phynancièrement plus abordables : on
trouvera un exemple de TC/scan fabriqué à la maison en
http://super8todv.free.fr/index.html
. L'auteur du site ne semble pas particulièrement animé de
motivations commerciales ; il donne aussi en
http://super8todv.free.fr/liens.html
la liaison vers la société canadienne MovieStuff qui fabrique
des systèmes légers mais plus professionnels travaillant image
par image ( http://moviestuff.tv/8mm_telecine.html
). Ces systèmes travaillent souvent pour les archives et les cinémathèques.
En France, un système comparable a été développé
par Suporfilm ( http://www.suporfilm.com/index.html
). Aux USA, on peut aussi citer le système Kinetta (
http://www.kinetta.com/download/files/Kinetta-Archival-Scanner.pdf
).
D'autres sociétés encore, en France ou ailleurs 7 , affirment procéder par scanning
plutôt que par télécinéma. Mais il n'en reste pas
moins que la grande majorité des prestataires de numérisation
grand-public se contentent de projeter le film et de filmer l'écran...
avec les résultats qu'on peut en attendre.
On observera que le vocabulaire même n'est pas encore fixé. Le
terme anglais "scanning" est souvent traduit en français par "balayage",
qui dans l'univers de la télévision et de la vidéo
traditionnelles sous-entend "balayage entrelacé", alors qu'il
s'agit justement de l'inverse, de balayage "progressif".
A.2- Définition
Actuellement, la définition standard des appareils de télévision
courants en Europe est de 525 lignes en analogique, ou 720*576 en numérique
(c'est la norme DV et DVD, aujourd'hui dominante).
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de numériser du film pour le
retravailler, il faut éviter toute compression, car les traitement ultérieurs,
agrémentés à chaque fois de décompressions et de
recompressions, vont dégrader la qualité de l'image, et même
créer des artefacts. Les formats de numérisation sont donc de
l'ordre de 2k (environ 2000 points à l'horizontale, environ 1500 à
la verticale) pour le 16mm, et 4k pour le 35m
On voit donc que la définition usuelle de la télévision
est largement inférieure à celle du film, et correspond tout au
plus au super-8mm.
Par ailleurs, depuis quelques années, la pression monte en faveur
d'un passage à la télévision haute définition
(TVHD). Une première tentative en ce sens avait déjà échoué,
à la fin des années 1980, le public n'étant pas très
enthousiaste à l'idée de changer déjà tout son coûteux
équipement tout neuf. Si l'actuelle offensive cette fois réussit,
il faudra tout de même plusieurs années encore pour que le parc
actuel soit totalement remplacé - et de toute façon, la définition
de la TVHD reste nettement inférieure à celle du 35mm, et même
du 16mm. Les numérisations déjà effectuées à
l'actuelle norme de 720*576 seront à refaire en HD. Et à quel
format ? il y a confusion entre la HD des scans de films pour le cinéma
(2k en général suffisant, 4k pour les travaux exceptionnels), la
HD des systèmes de tournage numériques (1900 pixels à
l'horizontale) et la HDV grand-public...
Il en résulte qu'il faut distinguer entre les formats de numérisation
pour l'archivage et le retravail, numérisation qui doit être
faite au maximum de définition et sans compression et sans entrelacement,
et les formats numériques de diffusion, nettement inférieurs et
compressés 8 .
A.3- Entrelacement
En Europe, la fréquence du courant alternatif du secteur est de 50
Hz (50 périodes par seconde), et de 60 aux Amériques et au Japon.
Aux débuts de la télévision, on fixa donc le rythme de
renouvellement des images à 25 images par seconde en Europe, et 30 par
seconde aux Amériques : cela permettait de synchroniser plus
facilement les machines, en adoptant un rythme le plus bas possible, compatible
avec la persistance rétinienne, et ne s'éloignant pas trop de
celui du cinéma. Plus précisément, profitant de ce facteur
2, et la bande passante étant limitée, donc pour des raisons de
simplicité technique et d'économie, on décida de
transmettre non pas 25 images par seconde, mais 50 demi-images par seconde
(resp. 30 et 60) : chaque image complète est analysée en
quelques centaines de lignes : l'une des demi-images est constituée par
les lignes paires, et l'autre par les lignes impaires. Ces demi-images ont reçu
le nom de trames (fram ), et la technique elle-même a reçu
le nom d'entrelacement (interlacing), car chaque image complète
est constituée de 2 trames successives entrelacées.
Un problème surgit immédiatement : lorsqu'on transfère
un film en vidéo, chaque image du film est transformée en 2
demi-images, deux trames. L'image 1 est transformée en trames A1 et B1,
l'image 2 en A2 et B2, et ainsi de suite. La suite des images du film s'écrit
donc A1B1A2B2A3B3... Mais si l'on décide de revenir aux images de départ,
rien ne permet de caler indubitablement quelle est la première trame: la
paire, ou l'impaire? Il n'y a donc qu'une chance sur deux pour que l'image 1
recomposée soit égale à A1+B1, l'image 2 à A2+B2,
etc.
On peut tout aussi bien se retrouver avec des images recomposées
de la forme A2+B1, A3+B2, A4+B3, etc. Ce n'est pas très gênant si
les images sont à peu près identiques. Mais si elles sont
nettement différentes, il en résulte des effets de peigne. En défilement
continu, il en résulte des effets de vibration, d'aller-retours entre
deux images successives, de dédoublement. Or, comme on sait, certains
films expérimentaux jouent énormément sur des successions
d'images très différentes les unes des autres: (films à
clignotements -"flickers"- , rafales d'images hétéroclites...).
L'entrelacement d'images nettement différentes les unes des autres est
bien visible en projection, et plus qu'incommode pour les retravailler image
par image. Mais ce n'est que depuis peu que l'on peut numériser un film
en mode non entrelacé (progressif) 9
.
A.4- Vitesse
La vitesse standard des projections de films est en général
de 24 images par seconde, mais parfois 16 ou 18 i/s pour les films anciens ou
de petit format. Pour les transférer sur bande vidéo, à 25
ou 30 images/seconde, il faut donc soit accepter une accélération
du film, soit rajouter des frames ou des images complètes entre les
images originales du film. On connaissait déjà le problème
pour faire des copies contemporaines à 24 i/s de ces films à 16
ou 18 i/s : usuellement, on redoublait une image sur deux, d'où
l'aspect saccadé des vieux films.
Le passage en vidéo est plus compliqué, surtout s'il s'agit
de passer de 24 ou 25 i/s à 30 i/s, ou réciproquement. Il n'y a
pas de solution simple à ce problème 10
Le problème ne se pose pas du tout en infographie : lorsqu'on
constitue un fichier informatique vidéo (un "film infographique")
à partir d'une suite d'images séparées, la vitesse de défilement
est fixable ad libitum. Le mieux serait donc semble-t-il de numériser le
film image par image (scanning et non pas télécinéma), de
façon à constituer un quasi-original, et de procéder
ensuite aux traitements informatiques les plus adaptés à
l'objectif visé
A.5- Etalonnage (rendu de couleurs, intensité lumineuse,
contraste et colorimétrie)
Les films expérimentaux jouent souvent sur le contraste, la sous- ou
la sur-exposition. Ils poussent la pellicule à ses limites. Sur la
plupart des caméras et appareils photo numériques usuels, il
n'est pas possible d'agir finement sur les réglages des capteurs, qui
ont été calculés pour des éclairages "normaux",
moyens, et réagissent plutôt mal à tout ce qui n'est pas "lumineusement
correct". Les zones sous exposées deviennent noires, les zones
sur-exposées deviennent blanches plus ou moins colorées.
La dynamique du film est supérieure à celle de l'image vidéo,
et en informatique, numériser sur 8 bits est insuffisant.
Il n'y a pas de solution simple à ce problème, hormis de
faire plusieurs passages avec des réglages différents selon les
problèmes rencontrés, et de reconstituer ensuite le
quasi-original par montage, incrustation, etc. De toute façon, en bout
de chaîne, chez l'utilisateur final, le film numérisé
aboutira souvent sur un téléviseur ou un écran
d'ordinateur quelconque, qui ne sera pas étalonné, et dont la
qualité d'image ne sera pas toujours optimale.
A.6- Restauration
Pour restaurer un film, il faut le retravailler image par image (nettoyage
des poussières et rayures, restauration des couleurs virées, rétablissement
du rythme, etc...). Là encore, il vaut mieux partir d'un fichier
infographique qui soit la copie la plus fidèle possible du
film-pellicule d'origine, qu'à chaque image du film sur pellicule
corresponde une et une seule image infographique, autant que possible sans
ajout, compression ou suppression d'aucune sorte. Ce qui permet aussi éventuellement
le retour sur pellicule quasiment à l'identique.
Certains actes élémentaire de restauration peuvent être
automatisés (élimination des scratches, rayures et poussières,
égalisation de la lumière, stabilisation...) mais dans certaines
limites seulement 11 .
L'intervention humaine nécessaire se chiffrera en une quantité
d'heures de travail, et donc un coût, non négligeables..
A.7- Compression
Les volumes de données mis en jeu par le cinéma numérique
sont énormes par rapport à ceux mis en jeu par le texte, ou même
par le son. Dans leur Rapport final sur " La numérisation de
l'industrie du cinéma ", Olivier Bomsel et Gilles Le Blanc notent
que :
" Ce qui distingue, notamment, le cinéma des autres
biens informationnels, c'est l'exceptionnelle densité des informations
contenues dans un film : une douzaine de terabits (douze mille milliards de
bits) pour un film long-métrage en 35 mm, soit l'équivalent d'un
million de séquences musicales MP3 ou de l'ensemble de la Bibliothèque
du Congrès. Difficile de dire s'il existe un lien entre cette densité
et la puissance émotionnelle du cinéma, mais ce qui est sûr,
c'est que le film de cinéma présente au spectateur, dans un temps
limité, plus d'informations, et donc plus d'atomes de sens qu'aucun
autre support matériel connu. "
(
http://www.cerna.ensmp.fr/Documents/OB-GLB-Cinema-Rapport.pdf
)
En définition télé standard, de l'ordre de 720*576
(correspondant rappelons-le à peine au super-8mm), il faut compter 2
gigas par minute (4 fois plus pour le 16mm, et plus de 16 fois plus pour le
35mm ; quant au 70mm, n'en parlons pas, le cinéma expérimental,
presque toujours artisanal et désargenté, n'y a pratiquement
jamais touché).
Pour manipuler, transmettre, distribuer de tels volumes, il est souvent
souhaitable et même nécessaire de les comprimer (le débit
d'un DVD est au maximum de l'ordre de 9 mégas par seconde (8 pour
l'image et 1 pour le son). Malheureusement, les compressions sont souvent
destructrices (on ne peut pas remonter à l'image originale), et peuvent
générer des artefacts lors de traitements ultérieurs.
Lorsqu'on veut constituer des quasi-originaux, il convient donc de
n'effectuer qu'un minimum de compression, la moins destructive possible, et le
plus tard possible.
La compression MPEG est adaptée au cinéma (et à la télévision)
dominants, prévisibles - les gens qui font un cinéma imprévisible
ont donc des difficultés.
A.8- Archivage et stockage
Une fois le quasi-original mis au point, sans compression, on l'a vu, les
volumes se chiffrent en dizaines de gigas. Un DVD-rom est insuffisant, sauf
pour les films de courte durée ; il faudra donc stocker sur disque dur,
ou sur bande.
Par ailleurs, un film transformé en fichier informatique est
virtuellement éternel... mais pas son support. Les disques durs comme
les bandes ont une durée de vie limitée, il faut donc multiplier
les sécurités (recopies à l'identique), et les étager
dans le temps
Finalement, si l'original est en bon état, on en vient à se
demander s'il ne serait plus simple, meilleur marché ou pas tellement
plus cher, d'en rester au support film pour l'archivage : le tirage d'une
nouvelle copie film de bonne qualité permettrait d'attendre quelques
dizaines d'années de plus que l'infographie se stabilise.
B.- Diffusion
Depuis les années soixante, la plus grande partie du cinéma
expérimental est en 16mm (de même que le cinéma
ethnologique, scientifique, documentaire en général...). Or, la
possibilité de projection en 16mm est de plus en plus rare, et encore
plus en salle : le parc de salles équipées en 16mm est en
constante diminution depuis les années 80, et tend de nos jours vers zéro.
En contrepartie, la puissance et la qualité des vidéoprojecteurs
s'améliorent régulièrement, cependant que leurs prix décroissent
; leur puissance de feux reste cependant inférieure à celle des
projecteurs de cinéma, et ne convient qu'aux salles petites ou moyennes
12
La plus grande partie de la diffusion dans l'avenir passera donc par ces
moyens, et de plus en plus à partir de fichiers infographiques plutôt
qu'à partir de bandes magnétiques. Il en résulte que ces
visionnements tiendront souvent plus de la consultation individuelle que de la
projection très collective. Pour cette raison, et pour quelques autres déjà
mentionnées, il restera souhaitable de pouvoir revenir au support film à
partir des fichiers infographiques quasi-originaux ; mais les fichiers destinés
à la diffusion seront évidemment compressés
On commence à voir apparaître des tentatives de diffusion du
cinéma expérimental sur support numérique, en ligne ou
hors-ligne. Citons-en quelques-une
Il y a aussi quelques diffusions TV (sur ARTE, et donc en TNT, l'émission
La Nuit -
http://www.arte.tv/fr/art-musique/die-nacht-la-nuit/L-emission-et-l-equipe/261180.html
) ou en ligne ( http://www.plastic-tv.com/index.php
) 15 .
Signalons aussi une tentative de nouveau format de diffusion, différent
de l'AVI et du Quicktime : Matroska (du russe matriochka, poupées
russes gigognes - http://www.matroska.org/index.html
, http://www.matroska.org/index.html.fr
, http://www.commentcamarche.net/video/mkv-matroska.php3
, http://matroska.free.fr/downloads/shellextension/
).
Enfin, en supposant réglés les problèmes de la numérisation,
et une fois constitués les quasi-originaux, continuera à se poser
un problème de fond, qui n'est pas près d'être réglé
: celui de la documentation, de la description et de l'indexation du contenu
des films...
1.2.- Intervention de Pip Chodorov
Pip Chodorov On a des centaines, des milliers de films qui
s'entassent, et on arrive à l'ère numérique où tout
le monde veut voir ça sur ordinateur. Il y a une grande partie des films
pour lesquels - pourquoi pas ? Mais il y a un certain nombre de films qui
sont très fragiles par rapport à la traduction vers l'image électronique,
qui ne peuvent pas être traduits
Il y a de grandes différences entre l'image photochimique et l'image
électronique, entre les grains et les pixels. Les pixels sont réguliers
et les grains sont disposés au hasard. Le contraste de la pellicule
chimique est beaucoup plus étendu que celui de l'image électronique ;
avec cette dernière, on perd donc des détails aux deux extrémités
de la gamme, dans les zones très claires ou très sombres. La
lumière n'est pas la même : avec un projecteur cinéma
les noirs sont noirs et les blancs sont blancs, ce qui n'est pas le cas avec un
projecteur électronique.
Il y a aussi des différences plus sémiologiques : un
projecteur de cinéma nous présente 24 fois par seconde une image
entière ; c'est donc un espace qui crée le temps. Alors
qu'avec un projecteur électronique, c'est un point qui balaye un écran
phosphorescent, c'est un point qui bouge dans le temps et qui crée
l'espace. Ce sont deux approches différentes pour créer une image
sur un écran.
Je suis arrivé au problème parce que j'ai démarré
il y a une dizaine d'années une activité d'éditeur et de
distribution de cassettes vidéo de films expérimentaux 16 . On ne pouvait pas trouver ces films
auparavant. Des cinéastes comme Brakhage, Bokanowski, Deren, etc, ont
travaillé le cinéma comme on travaille les arts plastiques.
Lorsqu'un peintre fait un tableau abstrait, non figuratif, on ne va pas dire
que c'est un peintre expérimental ; alors que pour un cinéaste,
si on fait un film abstrait, on est tout de suite relégué dans un
zone très marginale qu'on appelle cinéma expérimental.
C'est une sorte de no man's land.
On ne trouvait pas ces films à la FNAC. Je suis donc arrivé à
la FNAC avec des cassettes vidéo : au début, ils n'en
voulaient pas, et comme ça s'est vendu un peu, ils ont fini par en
prendre... Il y a trois ou quatre ans, la FNAC n'a plus voulu de cassettes ;
ils ne veulent plus que du DVD. Personnellement, je trouve que le DVD est
beaucoup trop compressé pour ces films, je ne vais pas les faire, et
donc, du coup, les films sont devenus moins visibles ; on est de nouveau
marginalisés, parce que le monde a adopté un support moins bon,
qui rend moins bien compte de toutes les astuces que ces cinéastes ont
essayée
Voici différents sites vous donnant des précisions sur les
différences entre pellicule cinéma et image vidéo 17 , les différences de contraste
(la pellicule est beaucoup plus dynamique) 18
, la résolution et l'acuité de l'oeil 19 . Et voici des comparatifs 20 entre le DVD standard actuel, le
BlueRay (Sony et Philips, sorti au Japon il y a quatre ans) et le DVD
Haute Définition (HD DVD , de Toshiba-Microsoft), qui sont les
successeurs annoncés du DVD. On voit par exemple que le DVD peut stocker
sur une couche environ 5 gigas, et leBlueRay 25 - cinq fois plus ;
le débit est de 11 mégabits par seconde pour le DVD, et 37 pour
le BlueR 21
. Avec ces nouvelles techniques, on s'approche de quelque chose de
correc
Prenons comme premier exemple le film de Jeff Scher intitul&eacut; Yours,
qui date de 1997.
Ce film est deux choses à la fois :
- c'est du found footage, c'est à dire de la pellicule récupérée,
un vieux film de 1945 qui a été retravaillé ;
- et c'est un film de peinture, non pas sur pellicule, mais sur papier,
refilmée image par image.
Jeff Scher a pris les noirs et les blancs du vieux film comme deux
masques, il a rempli les noirs avec un film de peinture A, et les blancs avec
un film B. C'est très rapide.
Examinons image par image les tests d'encodage sur DVD : on voit tout
de suite de gros problèmes. Dans cette zone bleue, c'est le même
bleu partout, alors que dans le film, ce sont des bleus différents. Dans
les zones très compressées, on voit des rectangles, des
macroblocs, alors qu'il n'y a pas de rectangles dans le film.
Passons maintenant une copie VHS du même film : la couleur est
beaucoup plus intense, il n'y a pas de problèmes d'artefacts ni de
macroblocs.
Enfin, projetons le film 16mm : on voit bien que ce n'est pas
exactement " le même film ".
Ce film n'est pas fait pour la compression, parce que le MPEG a été
inventé pour des images prévisibles, naturelles, pour des
mouvements. Considérons par exemple un camion qui traverse le champ :
à partir d'une image, l'ordinateur va pouvoir prévoir la
suivante, et puis encore la suivante. On obtient des GOPs, des Groups Of
Pictures, des groupes d'images, à l'intérieur desquels, entre
deux images-clés, il n'y a que des images prédites
Dans un film comme celui de Jeff Scher, on ne peut pas prévoir,
parce que c'est complètement différent d'une image à
l'autre. Regardons très agrandie la bande-film par transparence en rétroprojection :
on voit bien que toutes les images sont complètement différentes
les unes des autres. Et donc, ce n'est pas compressible. C'est un projet cinématographique
qui est antinomique à la compression. Si le DVD ne peut pas en rendre
compte, et si je veux faire une édition grand-public que l'on trouve à
la FNAC, qu'est-ce que je peux faire ? En attendant le Blue-Ray,
j'en reste au VHS, parce que toutes les images sont là. Ce n'est pas le
meilleur format, mais c'est comme une photocopie d'un tableau...
Voyons un autre exemple : j'ai fait des tests de transcription sur DVD
d'un film de Rose Lowder. Dans ce film, Rose Lowder, qui tourne avec une Bolex
image par image ; tourne dans trois lieux différents ; dans
le premier lieu A, elle prend une image sur trois : 1, 4, 7, 10, etc. Puis
elle rembobine la pellicule et se rend en un autre endroit, le lieu B, où
elle recommence avec un décalage d'une image : 2, 5, 8, 11, etc. Et
enfin, elle recommence pour le lieu C, en se décalant encore d'une image :
3, 6, 9, 12, etc. Le résultat, ce sont trois scènes différentes,
dans trois temps différents, ABCABCABCABC etc, qui se superposent sur la
rétine.
Mais pour la compression numérique, c'est évidemment très
mauvais.
Si on examine image par image, on voit très bien qu'il n'y a pas de
nuances de couleur, il n'y a que trois bleus différents dans le ciel, il
y a de gros carrés, des artefacts ; des macroblocs, pas de détails
dans les ombres, ni dans les zones claires, il y avait trop d'information dans
le film original.
1.3.- Discussion
XXX- intervenant non identifié du fond de la salle.- Y
a-t-il des moyens d'analyse de l'image en tenant compte des intentions
originales du créateur ? un peu comme on analyse une peinture ?
Pip Chodorov.- Dans les laboratoires, on peut très bien tout
capter. En 4k, chaque grain de la pellicule est couvert par 8 ou 12 pixels.
Mais on ne peut pas le transmettre au consommateur. Même pas en haute définition :
le Blue Ray contient 5 fois plus de données que la définition
standard du DVD, il est 5 fois plus rapide, mais les fichiers sont aussi 5 fois
plus lourds. Je serai peut-être contraint de faire des films en SD sur la
technologie HD....
Jean Moskowski (SuporFilm) Qu'est-ce qui oblige à
compresser les images ? Ce sont des films assez courts, on peut en mettre
moins sur un DVD, ne pas les compresser, et les visionner avec les outils qui
maintenant sont standard sur les machines, sans passer par un lecteur de salon.
Pip Chodorov On est limité par le débit du DVD-vidéo.
Jean Moskowski.- Je ne pensais pas au DVD-vidéo, mais au
DVDrom.
Pip Chodorov.- Ca, c'est autre chose. Mais ce n'est pas un format
pour le consommateur. J'ai envisagé de vendre des disques durs. Mais je
me suis dit qu'il n'est peut être pas souhaitable de diffuser un produit
qui est aussi bon qu'un master..
Jean Moskowski.- On retrouve des exigences du même ordre dans
l'archivage des films très abîmés : contrairement à
ce qu'on pourrait penser, plus un film est abîmé, plus il va être
difficile à compresser, puisque les altérations ne sont pas prédictibles.
Pip Chodorov.- La meilleure façon de stocker en non-compressé,
c'est sur pellicule. Un film noir et blanc peut espérer durer 200 ans...
Le problème n'est pas là, le problème est que plus les
technologies progressent, plus c'est de pire en pire. On voit bien qu'entre le
disque vinyl, le CD-audio et le mp3, il y a un problème. Entre la
cassette Beta, le VHS et le DVD, il y a de moins en moins d'information, et on
dit que c'est nouveau, c'est meilleur. C'est un lavage de cerveau.
XXX- intervenant non identifié du fond de la salle.-Mais le
vinyl, ça marche très bien ; c'est même mode,
tendance...
Pip Chodorov.- Techniquement, le vinyl est meilleur, même si
la plupart des gens n'entendent pas la différence. Et l'oeil est encore
plus difficile que l'oreille. On voit les problèmes. Les couches
sensibles de la rétine sont composées de cônes et de bâtonnets
22 , qui sont beaucoup plus
sensibles et nombreux que les pixels ou les grains de la pellicule. On peut
calculer qu'il y a dans chaque oeil l'équivalent de 320 mégapixels
23 , alors qu'il n'y en a que 6
dans un appareil photo numérique... Et derrière, il y a dans le
cerveau des systèmes de neurones qui analysent le champ visuel en termes
de mouvements, de contours, de reconnaissance des objets. C'est à ce
niveau-là que se créée l'illusion du mouvement : le
spectateur crée des ponts entre les images pendant les noirs 24 fois par
seconde. On a des quantités de neurones qui agissent en parallèle,
c'est beaucoup plus complexe et tout à fait différent de la
compression MPEG.
Après le BlueRay, on devrait avoir des procédés
de stockage holographique. Dans 50 ans, le DVD paraîtra aussi primitif
que les films de Méliès nous paraissent aujourd'hui. Fin 2002
j'ai publié un article contre le DVD dans le numéro spécial
hiver 2002 des Cahiers du Cinéma " Les 100 meilleurs DVD de
l'année ", j'ai hâte de passer à autre chose...
XXX- intervenant non identifié du fond de la salle.- Et la
sculpture holographique en mouvement
Pip Chodorov.- Je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper.
Alain Montesse.- il y a eu des essais, à Saint-Louis.
Intervenant non identifié.- Il y a eu un film russe,
aussi...
Alain Montesse.- Mais le problème que soulevait Pip subsiste :
même si ça marche dans un labo, à qui le vendre et à
quel prix ?
Deke Dusinberre Au delà de la qualité de
l'enregistrement, il faut aussi prendre en compte la façon dont l'image
est présentée au spectateur : projection cinéma,
visionnement VHS ou DVD par projection ou sur petit écran... et ce
dispositif de re-présentation joue énormément, on en a eu
ce soir la démonstration éclatante.
Pip Chodorov.- Certains artistes s'en fichent éperdument,
ils veulent que ce soit projeté, peu importe comment, et moi, ça
me gêne beaucoup, parce que c'est moi qui dit non.
Alain Montesse.- Il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, mais
nous ne devrions pas être déçus du résultat, c'est :
que reste-t-il de ce que nous sommes en train de faire à l'autre bout du
réseau, diffusé en RealMedia ? Cela fait aussi partie de
l'expérience.
Pip Chodorov.- La Fondation Cartier m'a demandé s'ils
pouvaient projeter les films de Oskar Fischinger lors d'une soirée, en
Beta. J'ai dit non, parce que la famille Fischinger, que je connais bien, n'est
pas du tout d'accord ; par contre, le film est facilement disponible en
16mm à Paris, ce n'est pas moi qui le loue, il suffit d'appeler la coopérative
Light Cone. Ils ont dit non, on ne va pas projeter en 16mm, on n'a pas ce qu'il
faut. J'ai proposé de venir faire la projection en amenant le
projecteur, ils ont dit non, dans cette soirée, on veut juste lancer une
cassette - en fait, ils avaient le projecteur 16mm, mais ils n'avaient pas
envie de changer de format. J'ai dit " dans ce cas, ne montrez pas
Fischinger "
C'est aussi la mentalité des gens, ils
connaissent peut-être l'histoire de la peinture, mais pas celle du cinéma,
ils n'ont pas l'idée de projeter ça comme il faut. Moi, je me
bats tout le temps pour cela, même si c'est contre mes propres intérêts,
je fais l'effort de me déplacer avec le projecteur alors que je
pourrais vendre beaucoup plus mes cassettes. Le public n'y est pour rien.
Jean Moskowski.- Le seul intérêt de la numérisation
pour l'instant, en l'état actuel de l'art, c'est la consultation
documentaire. Mais pas la présentation de l'oeuvre d'art dans sa plénitude.
Alain Montesse.- La numérisation soignée a aussi une
autre utilité, c'est que nombre de ces films n'existent qu'en un seul
exemplaire. Security first
Pip Chodorov.- On a fait des centaines de cassettes du film de Jeff
Scher qu'on vient de voir, mais je refuse de faire un DVD. Alors que Jeff, il a
fait un DVD, qu'il vend très cher - 1000$ - dans une galerie. Mais il
n'en a fait que 10. C'est du marketing pour le marché de l'art ; je
lui dis " ce n'est pas bon, ton film n'est pas fait pour le DVD ",
il dit " bon, ces gens veulent acheter, je m'en fous ; c'est
vrai que ce n'est pas beau, mais qu'est-ce que tu veux... ". On
est dans une logique à l'envers, où des gens sont prêts à
payer plus cher pour des choses moins bonnes. Moi, je vends des VHS, pas des
DVDs, je vendrai des BlueRay dès que possible, je fais faire des
numérisations HD qui sont beaucoup plus chères, je dois trouver
l'argent, je n'ai pas le choix...
Alain Montesse.- Jusqu'à présent, nous avons surtout
parlé de choses déjà existantes. Concluons sur la création.
Le cinéma expérimental a été en grande partie rejeté
dans les limbes et l'underground par le développement de la vidéo
et la disparition progressive du 16mm. Toutefois, depuis quelques années
(depuis le commencement du déclin de la vidéo ?), il semble
reprendre de la vitalité.
Mais considérons spécifiquement
la création numérique par rapport au cinéma expérimental.
Considérons
les films interactifs ; je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup en cinéma
expérimental...
Pip Chodorov.- Si, les films lettristes. La pellicule compte pour
très peu, ce qui compte, c'est l'imaginaire des spectateurs, c'est la séance,
c'est le partage, c'est la générosité de donner l'acte créateur
au spectateur...
Alain Montesse Si l'on a pu connaître dans les années
90 quelques CD-roms de création, essentiellement de la part de musiciens
(Residents, Peter Gabriel, Prince...), il est symptomatique qu'on n'ait pas
encore vu apparaître de DVD de création. La quantité de
données à créer et organiser est telle que l'on n'a pas
encore trouvé mieux que d'y mettre des films déjà
existants, éventuellement agrémentés d'un emballage et de
quelques bonus.
Finalement, à y bien réfléchir, un film réellement
interactif n'est plus un film : c'est un jeu.
Autre chose : la plus petite unité de pensée
dans le cinéma traditionnel, ça a été la scène,
puis le plan. Dans le cinéma de trucage, ça a été
les différentes couches, les différents calques ou laye
dans les logiciels de composition d'image. Et ce vers quoi on s'achemine avec
le numérique, c'est que la plus petite unité de pensée va être
le pixel. On voit la quantité de travail s'il faut penser chaque pixel
d'un film un par un.
Il y a quelques années, avec l'apparition du
logiciel Flash, on a eu toute une floraison de petits films, avec même un
festival en ligne ( http://www.fififestival.net/
) 24 . Au départ, Flash était
un logiciel d'animation enrichie de fonctions de programmation : les éléments
à animer pouvaient être unis d'un script leur disant quoi faire.
Il a depuis étendu ses capacités à la prise en charge
d'images " réelles ", et sert actuellement à
mettre en ligne tout et parfois n'importe quoi sur YouTube ou DaylyMotion.
Encore autre chose : parmi les héritiers du cinéma
expérimental, il me semble qu'il faut mettre au premier rang les gens
qui font du VJying, les video-jockeys. Leur activité se développe
pleinement lors des séanceslive, en temps réel, mais on
en trouve des exemples et des retombées en ligne 25
Pip Chodorov.- C'est très pixellisé ; ils jouent
avec la pixellisation. Jusqu'à présent, on était dans une
optique à la Walter Benjamin : l'oeuvre d'art et sa reproduction.
Mais ça, c'est autre chose.
Alain Montesse Enfin, quelque chose va peut-être venir du côté
des téléphones portables. Ils commencent à intégrer
des caméras, et on va peut-être bientôt avoir quelque chose
qui sera au numérique ce que les caméras légères, à
main, 16mm, multi-fonctions, ont été au cinéma expérimental
argentique. Il y a déjà un festival de films tournés avec
des téléphones portables, Pocket-Films, créé à
l'initiative de Benoît Labourdette, qui malheureusement n'a pas pu venir
ce soir 26 ...
On fera le point sur tout cela l'année prochaine
2.1.- introduction d'Alain Montesse
Alain Montesse.- Je répète brièvement ce que
j'ai déjà dit l'an dernier : le cinéma a toujours été
expérimental, ça a toujours été un jouet plus ou
moins scientifique, et ce qu'on appelle cinéma n'est qu'un sous-produit
commercial du cinéma expérimental, et pas l'inverse. Se poser des
questions sur la numérisation du cinéma expérimental,
c'est se poser les questions les plus fondamentales à propos du cinéma
en généra
Depuis l'an dernier, pas grand-chose de nouveau sur le front des techniques
de numérisation : on en est toujours à numériser sur
8 bits par couleur, ce qui est très insuffisant, le Blu-ray et
la HD sont loin d'être généralisés, l'entrelacement
est toujours un cauchemar... Quelques petites choses nouvelles à
signaler toutefois :
- le 5 avril 2007 sur France Culture vers 14h15, Atom Egoyan rendait hommage
au cinéma expérimental en général et à
Michael Snow en particulier 27
;
- un site pertinent sur bien des points :
http://fiston.production.free.fr/telecinema/telecinema.htm
- en ce qui concerne la restauration, un logiciel (en fait, un plug-in pour
After-Effects) intéressant, basé sur l'analyse du mouvement :
http://redgiantsoftware.stores.yahoo.net/filmfix1.html#examples
; il opère plan par plan, mais comme on sait, dans le cinéma
expérimental, les limites d'un plan sont parfois assez difficiles à
déterminer...
- à signaler aussi Spot Remover, un filtre de nettoyage de film pour
VirtualDub, en http://konstant.freeshell.org/
. Celui-ci, comme le précédent, utilise une méthode
qui dans son essence n'est pas tellement éloignée de la
compression MPEG. Pour distinguer les taches, poussières, poils, rayures
et griffures, etc, des éléments dont la présence dans
l'image est légitime, le programme examine plusieurs images successives,
et essaye de déterminer les éléments qui se répètent
d'une image à l'autre, pas forcément exactement au même
endroit et pas forcément complètement identiques à leur
occurence précédente. Il s'agit d'arriver à repérer
les éléments qui ne sont présents que sur une seule image,
ne semblent pas faire partie de la mémoire du film, et qui de ce fait
sont réputés parasites, illégitimes, et seront donc effacés
et remplacés par ce qu'on trouvera de mieux dans les images alentour. On
aura reconnu la pratique de la rustine, bien connue des praticiens du vélo
et des réparateurs de casseroles. Comme les logiciels de compression,
ces logiciels de restauration ne peuvent donc bien fonctionner que sur des
films prédictibles.
- au plan de la diffusion, il faut aussi souligner, d'un côté
la multiplication des lecteurs portables de DVDs, dans les trains, les avions,
à l'arrière de la voiture pour faire tenir les gosses tranquilles
dans les embouteillages lors des départs en vacances ; et surtout
l'explosion des sites de partage vidéo, myspace, dailymotion, youtube,
kewego, et bien d'autres. Voici par exemple un petit film à la jonction
des cinémas expérimentaux artistique et scientifique :
http://www.dailymotion.com/cluster/creation/commented-week/video/x1xfbr_lart-du-son
(on applique un son à une plaque vibrante de couleur sombre, sur
laquelle on a répandu une poudre blanche, peut-être de la farine :
sous l'effet des vibrations, la poudre dessine des motifs graphiques abstraits
qui évoluent avec le son).
L'an dernier, j'avais cité, entre autres exemples, le DVD du Cinéma
Différent édité par Lowave ; j'ai depuis trouvé
en ligne les commentaires de Stéphane Marti :
" Objectif Cinéma : Comment voyez-vous l'avenir
du cinéma expérimental avec l'arrivée de ces nouvelles
technologies comme le DVD ?
Stéphane Marti : Pour le cinéma
expérimental, le DVD ne paraît pas encore au point. Dans certains
films de cette catégorie, en source argentique, on décèle
souvent énormément d'informations visuelles sur un seul et même
plan, voir même sur une suite de quelques photogrammes (gestuelle frénétique
de la caméra, contraste violent des lumières, interventions
plastiques, etc.) et la compression en DVD est loin d'être performante.
Ce qui n'est pas le cas avec des films plus " classiques ". Pour
l'instant nos transferts en BETA puis en copies mini-DV ou VHS sont très
corrects et les plus fidèles possible de la source. Pip Chodorov,
premier éditeur de films expérimentaux en transfert vidéo,
envisage bientôt de basculer sa collection sur un nouveau système
de compression DVD, le Blu-ray [Disc]. Voyons donc... Quoi qu'il en soit, je
vous rassure, le DVD du collectif, dont certains films sont déjà
tournés en numérique est de bonne qualité. "
28
Bien, nous voila rassurés.
2.2- Intervention de Dominique Willoughby
Dominique Willoughby.- Je vais me servir d'un média
classique, la paro (rires dans l'assistance). Au démarrage, je
suis cinéaste expérimental, je suis enseignant au département
cinéma de l'université Paris-8 à Saint-Denis, et je
m'occupe d'une association, Cinedoc, qui depuis une trentaine d'années
conderve, recherche le patrimoine du cinéma expérimental, le
diffuse, le restaure - et récemment, nous avons tenté l'aventure
de l'édition DVD. J'ai édité en 2005 la première édition
vidéo des oeuvres d'Alexandre Alexeïeff, et l'an passé, j'ai
fait un DVD des oeuvres de Norman McLaren.
Il faudrait un semestre entier de conférences pour faire le tour des
question actuelles sur le cinéma expérimental et la numérisation,
je vais essayer de résumer la situatio
Le cinéma expérimental est apparu, du point de vue
artistique, dans les années 1920, avec l'avant-garde. Les origines expérimentales,
scientifiques, du cinéma remontent au début du XIXème siècle :
l'expérience de la farine sur une plaque vibrante remonte à
Faraday, or Faraday est partiellement à l'origine du cinéma,
puisque c'est lui qui a montré qu'une roue à fentes qui tourne,
vue dans un miroir à travers ses fentes, a l'air immobile ; c'est
l'illusion dite " roue de Faraday ".
On est donc sur deux axes distincts, artistique et scientifique. Il y a
pourtant un point de coïncidence, puisque les gens qui travaillent
aujourd'hui à traduire les oeuvres anciennes en numérique se
posent presque des questions de cinéastes expérimentaux :
ils reviennent à l'image par image, à toutes les informations qui
constituent un film : est-ce qu'on privilégie le mouvement, est-ce
qu'on privilégie la définition de l'image ? On est entre ces
questions quand on fait de l'édition DVD.
Il y a plusieurs problèmes qui se superposent.
Il y a un problème de sauvegarde d'un très important
patrimoine, qui n'est pas résolu parce qu'on n'a pas, dans le cinéma
expérimental, les moyens financiers nécessaires. Les technologies
existent : on pourrait scanner, en très haute définition, et
revenir au film, comme on le fait pour les films industriels à effets spéciaux,
35 et même 70mm. De nos jours, on se détourne de la restauration
traditionnelle, argentique, même si les Archives en font encore. Considérons
la restauration d'une publicité en animation d'Alexeïeff des années
30 : elle durait environ 3 minutes, et la restaurer en argentique coûterait
une fortune. Potentiellement, on pourrait le faire dans la filière numérique,
mais ce ne sont pas des films qui génèrent un flux financier
suffisant pour trouver des investisseurs ; les mécènes
n'existent plus, ils placent leur argent dans l'art contemporain, il n'y a plus
de vicomte de Noailles pour financer les films de Man Ray.
Le problème de la restauration est lié à celui de la
conservation. Notre collection est principalement en 16mm, on est centrés
sur tout sur les cinéastes des années 60-70, le 16mm est un
format en voie d'obsolescence, c'est difficile de projeter et les gens ne
savent plus le faire, c'est beaucoup moins pérenne et ça va
disparaître beaucoup plus vite que le 35mm.
Il y a aussi un problème de diffusion, de transmission. Supposons
les films scannés en haute définition, ils sont là sur
leurs disques durs, c'est une étape nécessaire. Maintenant,
qu'avons-nous comme supports de diffusion ? il y a le DVD SD, standard
definitio , et potentiellement le DVD HD, qui va arriver... sauf que les
prestataires attendent : personne ne veut investir dans des machines qui
coûtent des millions d'euros sans savoir quelle va être la vraie
filière. Il y a de grands groupes industriels qui investissent à
perte pour essayer d'emporter le morceau, on en est actuellement à trois
formats - oui, il y en a un troisième qui est apparu...
Il y a aussi le gros problème de l'internet : il y a quelque
temps, en lançant des recherches comme nous le faisons régulièrement,
nous sommes tombés sur un site belge, avec un garçon très
sympathique, qui a recopié tout notre DVD d'Alexeïeff, qui a pris
mes textes et les a mis en ligne, et qui a dit " allez-y, vous
pouvez télécharger, c'est bon ". Dès
l'instant qu'on édite un DVD, on est instantanément piraté.
Non seulement on n'arrive pas vraiment à gagner de l'argent, mais en
plus on alimente à perte des gens, très sympathiques au
demeurant, qui se présentent comme des sortes de Zorros modernes... La
diffusion genreYouTube a son utilité : je travaille en ce
moment à l'université sur l'avant-garde des années vingt,
j'ai un doute sur un film de Ruttman, je le trouve sur YouTub en basse
définition, c'est de très mauvaise qualité, mais comme
j'ai beaucoup vu les films en 35mm, je me le remets en mémoire ;
c'est un peu comme une mauvaise photocopie de travail pour un tableau, ça
peut rendre service
En termes de conservation, nous sommes arrivés à la
conclusion que pour le 16mm - pas pour le 35 -, la numérisation en haute
définition vidéo, sans compression, serait un support de
conservation intermédiaire acceptable : la définition n'est
pas trop éloignée de l'original. En termes de restauration, il
est vrai que, grâce au calcul, on a des possibilités sans
comparaison avec ce que l'analogique et l'argentique permettaient. On peut détecter
des points qui n'apparaissent qu'une fois dans une séquence. Au niveau
de la correction colorimétrique, et sous réserve que l'on ait un
opérateur qui ait la connaissance de l'oeuvre, même si l'on n'a
plus que des traces infimes de densité chromatique dans certaines zones,
on peut par le calcul reconstituer les valeurs originales - ce que l'argentique
ne permet pas.
Premier exemple : pour le DVD d'Alexeïeff, on a
retrouvé une publicité pour des cigarettes, où les
cigarettes battaient comme des baguettes de tambour sur un paquet de cigarettes :
les cigarettes étaient animées image par image. On a fait une
première passe avec un logiciel de détection de défauts
qui n'apparaissent que sur une seule image - logiciel qui s'appelle
l'Archangel et fonctionne en temps réel - : on a passé le
film, et il a effacé toutes les cigarettes.
C'est là que l'expérimental rencontre les limites de la prédictibilité.
Tous ces systèmes sont conçus pour des mouvements de caméra,
de personnages, etc.,. relativement cohérents. Mais comme le cinéma
expérimental a travaillé sur les limites des mouvements et de la
définition du cinéma - il y a l'exemple dadaïste de Man Ray,
qui avait saupoudré un film avec du sel, du poivre et des épingles,
ce qui produisait une sorte de mouvement brownien, il n'y a pas de mouvement réel
enregistré, mais un mouvement apparent pour le spectateur qui est un pur
produit psychique, en fait - tout ce genre de film ne passe absolument pas dans
ces logiciels, on revient toujours à un travail à la main, image
par imag
Ce problème du mouvement est à mon avis le problème
numéro 1 de la compression. La compression à l'intérieur
d'une image est toujours basée sur la redondance : on va chercher
des pixels de même couleur et contigus ; cela peut être tolérable.
Par contre, la compression MPEG, qui est basée sur la prédiction
et la rétroprédiction, pose problème. Une des définitions
du cinéma expérimental pourrait être d'explorer tous les
mouvements de synthèse : des mouvements non pas existants, mais
inventés. Or, tous les systèmes actuels de compression
travaillent sur des mouvements réalistes.
L'idéal serait d'arriver à ce que, provisionnellement, on numérise
ces films-là avec autant d'image dans le fichier qu'il y a d'images sur
le ruban argentique ; ainsi, on ne dénaturerait pas les effets, les
sensations de mouvement qui sont le nerf esthétique du cinéma expérimental.
Man Ray voulait un mouvement incohérent, il a eu un mouvement incohérent ;
Michael Snow dans Wavelength voulait un très long, très
lent glissé de 45 minutes - il ne faut pas toucher à cela. Mais
cela représente un segment économique trop insignifiant pour que
les industriels se penchent vraiment sur la question ; il reste des
chercheurs, des bénévoles, des passionnés pour s'en
occuper.
Autre exemple : Une autre publicité d'Alexeïeff
avait subi le syndrome du virage magenta : toute la couleur avait disparu,
à l'exception du magenta. Il restait des traces infimes de différenciation
chromatique. On utilisé un logiciel d'étalonnage, qui s'appelle
Da Vinci (plus on s'éloigne de la Renaissance et plus il faut baptiser
les logiciels de noms de peintres de la Renaissance...). On a réussi à
retrouver un point blanc, et aussi un point bleu (c'était un paquet de
Gauloises, je m'excuse, je n'ai aujourd'hui que des exemples fumeurs..). Ayant
retrouvé deux points chromatiques, on a retrouvé toute la gamme ;
et là, ça a été extraordinaire parce que pschht,
par le calcul, on a ramené cette image magenta à quelque chose de
très proche de la couleur originale. Bien sûr, on était en
définition standard, mais j'estime qu'avec ce DVD, quelqu'un qui a un
bon lecteur et un bon écran a une idée des films d'Alexeïeff
à 80% valable. Alors qu'avant, ne circulaient que de vieilles VHS sous
le manteau, NTSC, à 30 images par seconde...
Nous avons eu le soutien du CNC : en France, il y a un petit souci
patrimonial qui n'est pas encore abandonné - je ne sais combien de temps
cela va durer. Je travaille avec des éditeurs anglais qui en sont très
jaloux, eux, ils doivent tout faire à la débrouille, avec des
sponsors...
Et je vais terminer sur un dernier exemple, transatlantique. En 1954,
Norman McLaren avait un film intitulé Blinkity Blan . C'est un
film intermittent : il a gravé sur une pellicule noire, mais
seulement une image de temps à autre : disons une image gravée,
puis trois photogrammes noirs, puis deux images gravées différentes,
puis six photogrammes noirs, et ainsi de suite. C'est un film basé sur
l'augmentation de l'intermittence qui est constitutive du cinéma. Les
Canadiens ont publié un coffret, une édition intégrale,
qu'ils ont restaurée sur place, là bas chez eux, et nous, nous
avions une licence pour faire une édition limitée en Europe, une
sorte de best- . Je voulais faire une édition en PAL, qui a un
peu plus de lignes et donc davantage de définition, et qui a un débit
de 25 images par seconde, donc qui est beaucoup plus proche des 24
images/seconde du cinéma que les 30 images/seconde du NTSC. Ils nous ont
envoyé des versions restaurées de ce film, Blinkity Blank,
en Béta numérique, et là, on a vu des fantômes :
il y avait des interpolations d'une image à l'autre : pour passer
de 24 images/seconde à 30, toutes les 3 images, on fait une image en
fondu enchaîné. Il n'était pas question pour nous
d'utiliser cela. Par contre, sur leur édition DVD, ils avaient obtenu
des images parfaitement tranchées : quand on regardait image par
image, c'était parfait. Ils voulaient garder pour eux leur encodage, qui
est un gros travail, et nous faire faire un travail quasi-impossible, qui
aurait été, à partir des copies Béta à 30
images par seconde, de retrouver les 24 images/seconde originelles. Ce n'était
pas tout à fait impossible, notre prestataire aurait pu le faire, en
mettant un technicien dessus pendant deux mois... Finalement, on a réussi
à obtenir les masters MPEG, sur lesquels, en cliquant image par image 24
fois, on avait bien les 24 images différentes du film d'origine.
Alain Montesse.- Juste un détail, sur les rapports en cinéma
expérimental artistique et scientifique : tu avais autrefois édité
un petit ouvrage sur Jean Painlevé, n'est-il pas ?
Dominique Willoughby.- Oui, dans les années 80. Mais Jean
Painlevé est un cinéaste expérimental dans les deux sens.
Quand il a fait un documentaire sur la chauve-souris, il a mis du Duke
Ellington comme musique - ce qui est plutôt rare pour un scientifique. Il
a aussi fait l'un des premiers court-métrages d'animation en volume -
Barbe Bleue - en plasticine, en pâte à modeler, qui a eu
un destin tragique : le procédé couleur était du
Gasparcolor, qu'il fallait envoyer développer à Londres ou aux
Etats-Unis, une guerre mondiale est passée par là, le film est
resté bloqué en douane... il y a eu récemment un projet de
restauration, je crois.
Mais je m'intéresse beaucoup aux origines scientifiques du cinéma.
En ce moment, je travaille sur la reconstitution des disques stroboscopiques.du
XIXème siècle, c'est à dire l'animation d'avant le cinéma
photographique. J'ai fait un film à l'université en 1999, qui
s'intitule " Disques stroboscopiques du XIXe siècle ",
et je suis en train d'en faire une version numérique.
Finalement, il y a une autre problématique qui s'ouvre aujourd'hui,
c'est que le numérique devient un support de création. Nous avons
beaucoup parlé de comment faire entrer les anciens contenus dans les
nouveaux contenants ; mais on n'a pas encore tout à fait pris la
mesure des possibilités esthétiques de ce qui est en train de se
passer. Aujourd'hui, je crée directement au format DV sur mon
ordinateur, et je tiens compte du fait que ça va se terminer en MPEG. Je
travaille dans la lenteur et le fondu, et j'ai intégré une esthétique
de l'interpolation et du mouvement très coulé - d'abord parce que
ça m'intéresse, et aussi parce que j'essaie d'être en résonance
avec les outils dont je dispose à un moment donné. Lorsqu'on a
acquis un ordinateur et les logiciels, on a une certaine autonomie de
production : je fais directement la reconstitution de ces disques du XIXe
siècle via des logiciels d'animation, avec lesquels je peux avoir des
cadences, disons exotiques (tel disque est en 13 phases, tec). Nous sommes
encore dans une phase intermédiaire où nous sommes prisonniers
des cadences héritées de l'analogique, 24, 25, 30 images par
seconde, mais je pense que le numérique va permettre à chaque
film de générer son propre projecteur. Et là, il y a de
l'expérimentation de création à faire. C'est une note
d'espoir...
Revenons à la question : comment préserver encore un
certain temps les films anciens ? Nous sommes engagés dans un
processus sans fin. Autrefois, les peintures étaient liées à
la vie à la mort à leur support ; nous, dans le cinéma,
nous sommes des nomades du support : il faut transborder sans arrêt.
Virtuellement, le codage binaire est impérissable, mais le support ne
l'est pas. On pourrait faire comme Kubelka, faire graver dans le marbre tout le
code d'un film...
Alain Montesse.- Oui, ou un coup de laser sur des tablettes
d'argile, et ensuite on les fait cuire...
Dominique Willoughby.- Soyons ouverts ! (rires)
2.3.- Intervention de Benoît Labourdette
Benoît Labourdette.- Je suis ici à double titre :
je suis moi-même réalisateur, et j'ai aussi une société
de post production, Quidam Productions, qui fabrique des DVD pour les
producteurs, en particulier tous les DVD de Re:voir, la société
de Pip Chodorov. Et par ailleurs, je suis ici aussi en tant que coordonateur
d'un festival de films tournés avec des téléphones
portales, qui s'appelle Pocket Films ; c'est une initiative qui a été
proposée par le Forum des Images il y a trois ans, et la troisième
édition du festival aura lieu du 8 au 10 juin au Centre Pompidou. Dans
une perspective de création, il est étonnant de voir à
quel point le téléphone portable est proche du Super-8, aussi étonnant
que cela puisse paraître...
Etant moi-même directement engagé dans des processus de
compression numérique et faisant de mon mieux pour ces cinémas
peut-être un peu difficiles à transmettre parce que ne
correspondant pas aux codes qui ont été donnés par les
systèmes de compression numérique, je ne serai pas aussi négatif
qu'Alain et Dominique l'ont été. Il y a des problèmes qui
se posent et des questions à se poser, mais il y a aussi de nouvelles
pratiques à mettre en oeuvre. Ce n'est pas tant la technologie qui
importe que la façon d'utiliser la technologie. Ce ne sont pas les
machines qui permettent d'obtenir des résultats de bonne qualité,
ce sont des logiciels et la façon d'utiliser ces logiciels.
Le cinéma narratif, académique, n'est qu'une partie de tout
ce que l'on peut faire avec le cinéma, mais malgré tout, le cinéma
est avant tout une industrie, et le cinéma expérimental, dans
son économie, dans son mode de diffusion, est à la marge de cette
industrie. Il n'y a plus de mécènes, et on peut avoir quelques
craintes sur l'avenir des financements publics.
La vidéo HD est très proche du 16mm ; le 35mm est plus
défini à l'origine, mais regardons par exemple les 3 derniers épisodes
deStar Wars : ils ont été tournés en HD (1920
pixels par 1080) : pourquoi ? parce que cela permet une bien plus
grande souplesse de traitement, de montage, d'effets spéciaux... et
qu'au bout du compte, pour le spectateur, dans la salle, le résultat
final est au moins aussi bon qu'une copie optique qui est passée dans
son élaboration par plusieurs générations d'internégatif
Nous avons fait il y a deux ans le DVD de la réédition de
Mon Oncle / My Uncle, de Jacques Tati. On s'est alors rendu compte que
My Uncle n'est pas simplement le doublage de Mon Oncle ;
c'est un autre film. Il y a des plans qui sont communs, mais il y a aussi
beaucoup de plans différents, qui ont été tournés
directement en anglais (les acteurs parlent anglais, ou français avec
accent, les éléments de décor portent des inscriptions en
anglais, etc). Il y a donc deux films. Jérôme Deschamps, qui a les
droits du catalogue Tati, a décidé de restaurer le film My
Uncle en argentique,: ça a coûté extrêmement
cher, même s'il y a eu des soutiens financiers du CNC et de la Fondation
GAN ; il a fallu renoncer à certains points de la restauration -
par exemple, les collures sont souvent restées au scotch, ce qui
engendre à chaque changement de plans un bref et léger décalage
de l'image - ce qui n'était évidemment pas dans les intentions de
Tati. Le film My Uncle existe donc sur support argentique ; il est
sorti en salles durant l'été 2005, en anglais sous-titré
en français, la promotion étant orientée vers le public
enfantin ; ça n'a pas marché du tout, les gens n'ont pas
compris la nuance, il n'y a eu aucune entrée ou quasiment durant l'été
2005. Par contre, lorsque le DVD est sorti en octobre 2005, ça a été
la meilleure vente de la période pour les DVD de patrimoine : 30000
exemplaires vendus en 3 ou 4 mois. A l'époque, je leur avais conseillé
de faire un télécinéma HD, mais il ont préféré
rester dans la filière de restauration traditionnelle ; et
aujourd'hui, on projette My Uncle assez rarement, et on leur demande
souvent une copie numérique HD... qu'ils n'ont pas. Tout ça pour
dire qu'ils auraient fait tout cela en numérique, ça aurait coûté
moins cher et la restauration aurait pu être plus poussée ;
on aurait perdu un peu en définition, mais ça répondait
aux besoins de diffusion, et un master HDcam SR, c'est quand même très
bon.
Les modes de diffusion évoluent ; on n'y peut rien, c'est comme
ça. Et finalement, l'enjeu de tout cela c'est quand même de faire
circuler des oeuvres. Nous sommes des nomades des supports, et si le support
devient numérique, pourquoi pas ?
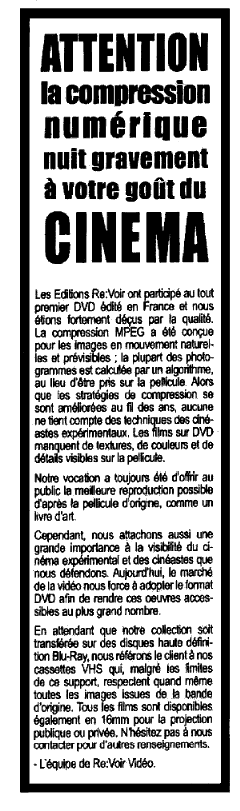 Autre exemple, notre travail pour les éditions Re:voir de Pip Chodorov
- qui met dans tous ses DVDs (c'est moi qui les fais, j'y mets toute mon
attention et tout mon coeur) ce message qui ressemble un peu à ce qu'on
voit sur les paquets de cigarettes :
Autre exemple, notre travail pour les éditions Re:voir de Pip Chodorov
- qui met dans tous ses DVDs (c'est moi qui les fais, j'y mets toute mon
attention et tout mon coeur) ce message qui ressemble un peu à ce qu'on
voit sur les paquets de cigarettes :
Le premier DVD sur lequel il a mis ça était un DVD de Stéphane
Marti. Ce sont des films en super-8, en 16mm, ça bouge dans tous les
sens, il y a du grain, ça a été un travail énorme,
mais sur un bon lecteur, ça fonctionne. Mais l'oeuvre qu'était le
film au départ a été complètement triturée,
analysée, vectorisée dans tous les sens - il y a une violence, on
analyse l'image pour la recomposer, mais au bout du compte, et même si on
visionne image par image, on a une reproduction de l'oeuvre bien plus fidèle
que ce qu'on a sur une VHS, ça se conserve mieux, ça ne s'abîme
pas quand on fait des arrêts sur image...
C'est un peu pourri, le VHS. C'est pour cela que le DVD a eu tant de succès.
Il repose sur une norme très stricte, qui a été élaborée
en 1994, et cette norme a été élaborée par et pour
une industrie qui est celle du cinéma académique : une sorte
de théâtre filmé, avec des gens qui se parlent, ça
ne bouge pas beaucoup. C'est pour ce genre de cinéma qu'a été
créée, compte tenu des possibilités techniques de l'époque,
la norme MPEG-2. Le maximum de débit de données de l'époque
était de l'ordre de 10 mégabits par seconde, ce qui était
tout à fait insuffisant pour lire un film non compressé. Le problème
est exclusivement là. Les techniciens ont donc eu l'idée, assez
maligne, des GOP, de Group Of Pictures, des groupes d'images. Au lieu
d'enregistrer toutes les images les unes derrière les autres, on
enregistrement seulement des images-clés (appelées images I), et
entre ces images clés, on enregistre seulement ce qui a bougé
dans l'image (les images P et B, qui ne sont même pas des images). Le résultat,
on le voit par exemple dans la télévision par ADSL, c'est
totalement merdique, dès que ça bouge, ça pixellise dans
tous les coins, c'est bien inférieur à la télévision
hertzienne pour peu que l'on ait une bonne antenne-rateau sur le toit... en même
temps, cela ne semble gêner personne. Je regardais récemment le
dernier James Bond sorti en DVD commercial normal : dans les scènes
d'action, ça pixellise grave. Et tout le monde s'en fout. Pip Chodorov
a fait il y a quelques années l'expérience suivante : il est
allé chez de gros prestataires fabricants de DVDs, qui ont des encodeurs
hardware, de grosses machines qui coûtent très cher :
on met à l'entrée une cassette bétacam numérique,
et on récupère en sortie un fichier MPEG-2. Il a fait des essais
avec des films de Brakhage, des choses qui bougent très très
vite, et au bout du compte, malgré toute la bonne volonté des
techniciens et la puissance des machines, ça pixellisait, ça
donnait ce qu'on appelle des macroblocs. Et un film de Brakhage qui va très
vite et pendant tout le film on ne voit que des gros carrés, c'est
insupportable, parce que l'attente du spectateur n'est pas la même que
pour James Bond.
Or ; il existe des encodeurs software, des logiciels qui
permettent de travailler l'encodage un peu comme on travaillerait de la
dentelle. On peut, avec des passes successives, affiner progressivement
l'analyse. J'ai récemment encodé un film d'une artiste,
simplement un plan fixe d'un paysage avec une rivière, des arbres, des
feuilles partout, un petit vent, donc en fait un nombre d'informations énorme...
Le truc, c'est de filtrer les hautes fréquences avant d'encoder, afin de
réduire la masse d'information. On passe du temps, on fait des tests, on
recommence jusqu'à trouver le bon réglage, et tout cela pour
rentrer dans une norme qui a été fixée en 1994, et qui
aujourd'hui n'a plus lieu d'être
Il est tout à fait possible de faire à partir d'un film un
fichier MPEG-2 qui ne contiendra que des images-clés. Ce sera tout à
fait comparable à un enregistrement sur bande DV, et on pourra graver ce
fichier sur un DVD. Mais ce fichier nécessitera un débit bien supérieur
aux 9,8 mégabits/seconde qu'autorise la norme DVD-vidéo, et il
sera refusé, même par les meilleurs lecteurs de salon, parce que
cela n'entre pas dans la norme.
On attend une nouvelle norme, supérieure, le DVD-Haute Définition ;
il y en a actuellement deux qui s'affrontent, le Blue-Ray et le DVD-HD.
Les enjeux financiers sont énormes. Actuellement, quand je fais presser
un DVD-video chez un presseur, le presseur verse une redevance pour chaque
exemplaire pressé aux détenteurs du copyright, des droits de la
technologie DVD-video. De même, pour chaque lecteur fabriqué, des
droits sont versés. C'est une poule aux oeufs d'or, et c'est pour cela
que les deux normes s'affrontent. S'ils n'arrivent pas à se mettre
d'accord, on aura des lecteurs qui sauront lire les deux... La HD concerne
aussi le marché de vidéo à la demande, ainsi que le marché
des écrans plasma, qui est en pleine expansion ; de nouvelles
usines sont construites chaque année...
Mais le problème de la compression va se poser exactement de la même
façon : une image HD est environ 6 fois plus grande (1920*1080) ,
contient environ 6 fois plus de pixels qu'une image SD (Standard Définition,
720*576), et du coup, il va falloir compresser.
Il n'est d'ailleurs pas sûr que la HD se développe aussi vite
qu'on le prévoit. Le DVD est déjà d'une qualité
telle que des exploitants de salles cinématographiques passent du DVD
sur grand écran ; et du coup, on croit presque que le DVD, c'est le
film, alors que ce n'en est qu'une reproduction. Quand on voit une carte
postale de la Joconde, on sait bien que ce n'est pas le tableau...
C'est tout cela qui gêne Pip Chodorov et les éditions Re:voir.
Il refuse de mettre en vente les films de Brakhage sur DVD Mais il n'a les
droits que pour la France...
Et d'autre part, avant de faire un DVD, on a un master vidéo, qui a été
fait à partir d'un télécinéma ; est-ce que le
film d'origine a été restauré, ou non ? en argentique ?
en numérique ? Lorsque j'ai fait le DVD de l'exposition Dada, j'ai
reçu pour encodage des master video dont la qualité était
une honte. Ce n'est pas forcément la faute du DVD, c'est toute une chaîne.
Un dernier exemple : l'association Point, Ligne, Plan est une
association de diffusion de films d'artistes. Elle souhaite mettre une
collection d'une cinquantaine de films en téléchargement payant
sur l'internet. Avec Christian Merlhiot, nous sommes arrivés à la
conclusion qu'il fallait le faire au format DivX ; c'est une compression
MPEG-4, plus récente et beaucoup plus efficace que le MPEG-2. On peut
faire tenir un film de une heure dans 700 mégas, au lieu de 3 gigas sur
un DVD, c'est assez rapide à télécharger et ça
tient sur un CD. Mais la problématique est la même, c'est à
dire que quand ça bouge, ça pixellise dans tous les sens, et la
solution est la même : il faut réduire la quantité
d'information, et on arrive à un objet nickel pour le spectateur. Même
si ce n'est plus le même film, Christian Merlhiot trouve le résultat
très bon.
De même, Pip Chodorov dit à Jonas Mekas : " Jonas,
pour tes films, c'est compliqué, ça va coûter très
cher... " ; et Jonas Mekas lui répond : " "Why
bother ? " - pourquoi s'emm...
Finalement, c'est aux artistes de prendre en compte les limitations
techniques pour leur diffusion. Il faut bien distinguer la conservation de la
diffusion. Le jour où il y a une projection en salle, c'est notre
responsabilité de professionnels d'utiliser le master HDcam, et pas une
copie DVD. Le DVD nous fait un peu confondre la diffusion et la conservation,
et il est important de voir clair là-dedans, car les enjeux sont différents.
Je peux très bien faire un télécinéma HD d'un film
expérimental, l'enregistrer sous forme de milliers d'images brutes numérotées,
et un programme comme Virtualdub, VLC, etc, pourra mes les relire, je verrai
mon film, je n'aurai aucun souci de compression.
2.4.- Discussion
Dominique Willoughby.- Pourquoi ne peut-on pas utiliser le divX
pour les DVDs ?
Benoît Labourdette.-Parce que la norme du DVD, c'est le
MPEG-2 ; si tu édites un DVD, il faut qu'il puisse passer dans tous
les lecteurs de salon des acheteurs, et seuls certains lecteurs récents
peuvent lire aussi le divX..
Alain Montesse.- Le divX est beaucoup moins commode à récupérer
que le MPEG-2 ; or, une bonne partie de l'activité créatrice
avec ces nouvelles technologies (VJying, sampling...) consiste à récupérer
des données pour en faire quelque chose de nouveau...
Benoît Labourdette Ces données sont des données
de diffusion, elles n'ont pas la qualité du produit d'origine.
ZZZ.- Quel est le rôle des instances publiques, nationales ou
internationales, pour la conservation ? Y a-t-il des normes pérennes
Benoît Labourdette.- Henri Langlois, au début, était
quasiment un pirate. La Cinémathèque française est une
association financée par l'Etat...
Alain Montesse En France, certaines instances dépendent du
Ministère de la Culture, d'autres du Ministère de la
communication (quand il y en a un)...
Benoît Labourdette.- A la BNF, on archive aussi les produits
interactifs. Il n'y a pas de norme générale. Ca évolue
tellement vite qu'il leur faudrait presque un ordinateur d'époque pour
chaque CDrom. Certains producteurs sont conscients du problème, d'autres
vont jusqu'à perdre leurs masters.
Dominique Willoughby.- A une époque, on détruisait
les films pour récupérer les sels d'argent. Ce n'est plus le cas.
Les producteurs ont bien compris que n'importe quel navet peut être
rediffusé. En France, on a maintenant le souci de la conservation et du
patrimoine, on a eu le plan nitrate... Pour le DVD d'Alexeïeff, j'ai
retrouvé les négatifs originaux, qui étaient dans des
labos, mais auxquels on n'avait pas accès, les producteurs ayant disparu
. C'est aussi un problème juridique : j'ai dû faire constater
la déshérence de certains producteurs auprès du Registre Général
du CNC, pour que LTC veuille bien nous laisser tirer une copie d'un film
d'Alexeïeff - pour lequel les ayant-droits nous avaient donné
l'autorisation. En ce qui concerne les normes techniques, ce sont toujours les
industriels qui ont réglé cela entre eux : le premier congrès
de normalisation du 35mm, c'était Méliès qui en était
le président, c'était en 1905, ils se sont mis d'accord sur les
perforations... La conservation des machines est un vrai problème ;
pour nos DVDs, nous avons travaillé avec Vectracom, fondée par
des anciens de l'INA qui ont eu le nez assez creux pour conserver toutes les
machines, jusqu'à des formats exotiques tels que les magnétoscopes
HD 2 pouces qui ont servi pour les Jeux Olympiques d'Albertville... Conserver
des oeuvres, aujourd'hui, c'est aussi conserver des machines - et les conserver
en état de marche.
Benoît Labourdette.- Pour le cinéma, en France, on est
assez bien loti. Mais pour toutes les oeuvres audiovisuelles des artistes, même
pour des oeuvres récentes, j'ai énormément de problèmes.
Les artistes eux-mêmes n'ont pas toujours ce souci...
ZZZ.- Le rôle de l'Etat est primordial
Dominique Willoughby.- Il y a aussi une responsabilité des
créateurs, au sens de producteurs, d'artistes, de financiers. L'Etat,
c'est qui ? C'est nous. Allons-nous, avec nos impôts, financer la
conservation des jeux vidéo d'Infogrames ?
Alexis Martinet (Institut de cinématographie scientifique)
Le dépôt légal prévoit que l'on doit déposer
la copie dans le meilleur format. En institutionnel, si on fait un film 16mm,
on doit déposer une copie 16mm : et comme souvent, il n'y qu'une
seule copie, ça double le prix. Le CNRS considère que ses
productions ne sont pas des films commerciaux, il dépose donc une
cassette vidéo, ou un DVD. Et nombre de producteurs privés en
font autant.
Lorsqu'on me donne un DVD, je ne sais jamais si je vais pouvoir
le lire ou non. D'où cela peut-il venir ?
Benoît Labourdette Les DVDs avec lesquels vous avez des
problèmes de lecture sont des DVDs gravés, et non pas pressés.
Lorsqu'on grave un DVD vierge avec son ordinateur personnel, on ne respecte pas
strictement la norme - on n'a pas le droit de mettre le logo DVD-vidéo
dessus. La norme concerne non seulement la compression, mais aussi l'authoring,
la gestion de l'interactivité, c'est le chas d'une aiguille par lequel
il faut passer. En 2001, Disney a dû rappeler son DVD d Roi Lion
et le refaire, il ne passait pas sur 40 modèles de lecteur parmi les 300
qu'il y avait à l'époque.Alain Montesse.- Disons pour
finir quelques mots des questions de création. J'avais déjà
évoqué l'an dernier du VJying, et parmi les nouveaux outils, le
plus important me semble être le téléphone portable - si
tant est qu'on puisse encore appeler ces engins des téléphones.
Benoît Labourdette.- Dans quelques années, tout téléphone
portable sera muni d'une caméra. C'est un changement socioculturel très
important. Il y a deux ans et demi, nous avons commencé à prêter
des téléphones à des artistes, des plasticiens, des écrivains,
des musiciens, en leur demandant de faire quelque chose avec. Et nous avons créé
le festival Pocket-Films - le prochain est prévu pour les 8,9 et 10 juin
au centre Pompidou. Avec cet outil, les gens redécouvrent une sorte de
caméra primitive, qui n'est pas sans rappeler le Super-8. Les gens ne
cadrent plus, ils brandissent leur téléphone, c'est une sorte
d'oeil greffé qui se rajoute, ce n'est pas une caméra au sens
habituel, narratif du terme...
Dominique Willoughby Là, je ne suis pas d'accord. C'est une
caméra, même si on l'a mise dans un téléphone ;
La caméra n'a pas été inventée pour raconter des
histoires. On n'aurait pas idée de mettre un téléphone
dans une caméra.
Robert Risler.- Je bondis ! La caméra n'est pas un
oeil, l'oeil n'est pas une machine. L'oeil est un bout de votre cerveau.
Alain Montesse.- Kino-glaz Dziga Vertov.
Alexis Martinet.- Quand vous tenez un portable au bout de votre
main, vous savez ce que vous faites avec votre main, comment vous l'orientez.
C'est comme si vous aviez un oeil au bout de la main. Et ça existe :
les biologistes peuvent greffer à une mouche un oeil au bout d'une
patte, et la mouche voit quelque chose. C'est comme avec un pistolet, on n'a
pas besoin d'avoir l'oeil derrière pour savoir ce qu'on vise.
Benoît Labourdette.- Ce sont de nouvelles compétences
que les gens vont acquérir avec ces objets hybrides. C'est de la
bionique à l'extérieur du corps.
Alain Montesse.- Dans les années 70, Aaton avait sorti une
caméra vidéo à main, qui s'appelait la Paluche.
Yvonne Mignot-Lefebvre.- Je me rappelle avoir assisté
autrefois à la soutenance de thèse de Dominique Noguez sur le cinéma
expérimental... Les espaces numériques dans lesquels on devait
ressentir plein de choses, le cyberespace, ça n'a pas eu beaucoup de
succès ?
Benoît Labourdette Depuis quelque temps, il y a un jeu en
ligne qui s'appelle Second Life ; ce n'est pas une virtualité
aussi directe qu'on l'imaginait, on n'y projette par l'intermédiaire
d'un avatar. Mais il s'y passe plein de choses.
Alain Montesse avait prévu de terminer la seconde visioconférence
par des considérations sur quelques rapports du cinéma expérimental
avec la théorie du chaos déterministe, il n'en a pas eu le
temps. Ce sera (peut-être) pour une prochaine fois. Disons brièvement
que le cinéma expérimental ressortissant largement du royaume de
l'imprévisibilité, tant techniquement que dans ses contenus
explicites ou implicites, dénotes ou connotés, latents ou révélés,
et étant pourtant complètement déterminé parce que
le film existe avant la projection (encore que...), une bonne partie des
discours tenus dans les années 1980 autour de la théorie du chaos
et de l'auto-organisation pourrait bien lui être appliquée. Qu'on
se rappelle par exemple la définition d'un objet complexe comme un objet
tel qu'il n'y ait pas de moyen plus économique de le décrire que
de l'énoncer entièrement (ce qui revient à définir
un objet complexe comme un objet qu'on ne peut pas simplifier - ce qui confine
à la lapalissade) : les difficultés de la compression du cinéma
expérimental peuvent être envisagées comme un cas
particulier de cette complexité-là.
3.1.- introduction d'Alain Montesse (résumé des épisodes
précédents, et news diverses)
Alain Montesse.- Je vais résumer brièvement ce qu'on
peut conclure de façon à peu près sûre à
partir des épisodes précédents.
- S'il s'agit de constituer à partir d'un film un quasi-original de
la meilleure qualité possible, c'est la numérisation image par
image qui s'impose ;
- J'avais parlé il y a 2 ans de machines fabriquées à
la maison par des amateurs et travaillant image par image : de nouvelles
machines de ce genre sont apparues depuis, par exemple :
-
Le principe est toujours le même : mettre face
à face une caméra et un projecteur modifié, et indexer la
vitesse du projecteur sur la vitesse de la caméra ; les détails
et modus operandi techniques sont clairement exposés sur les
sites.
- Il existe aussi des systèmes commerciaux :
-
Il devient donc possible
de numériser image par image à un prix "raisonnable".
Un problème subsiste : tous ces systèmes fonctionnent en définition
standard (SD, 720*576), alors que, si l'on veut un minimum de rationalité
économique, étant donné que l'argent ne peut guère
venir en quantités significatives que des rarissimes diffusions télé,
il est impératif de numériser en HD (1920*1080 progressif), car
la télé ne veut rien d'autre (par ailleurs, je rappelle que
techniquement, la HD correspond à peu près à la définition
du 16mm).
La construction d'une machine image par image HD coûterait
quelques milliers d'euros. Peut-être cela en vaut-il la peine.
Un
autre problème subsiste, pour lequel je ne vois pas de solution simple à
court terme : tous ces systèmes travaillent en 8 bits par
couleur...
- Pour la diffusion, la compression est nécessaire. Pip Chodorov a
exposé lors de la première séance les insuffisances du
MPEG, Benoît Labourdette en a pris la défense lors de la séance
de l'an dernier.
Depuis, on a vu arriver en force le format Flash (*.flv)
sur les sites de partage vidéo.
Le DivX continue à bien se
porter.
Enfin, il y avait une tentative de format ouvert, le format
Matroska, mais les dernières nouvelles sur le site
http://www.matroska.org/news/index.html
datent maintenant de près de 2 ans...
- En ce qui concerne la diffusion en DVD, le Blu-Ray a l'air de prendre
l'avantage sur le HD-DVD (bien vu, Pip!). M'enfin, ce n'est pas encore très
répandu. A l'exception de Re:Voir, qui publie régulièrement
de nouveaux titres, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'autres publications
depuis 2 ans...
Pip Chodorov.- Le Collectif Jeune Cinéma en fait, mais à
destination des programmateurs, pas dans le commerce.
| Alain Montesse.- |
|
- Diffusion en ligne : c'est le facteur nouveau, et de plus en plus
important. La quantité de choses mises en ligne sur YouTube, Dailymotion,
etc., a tellement augmenté que moi, j'ai renoncé ; il n'est
plus possible de tout voir, et de loin. Détail significatif, qui nous éloigne
du cinéma expérimental, mais qui est symptomatique de la
puissance croissante de ces nouvelles instances de diffusion : je passe la
parole à Thomas Baumgartner, nous sommes sur France-Culture, le
vendredi 25 janvier dernier vers 11:05, au début de l'émission
hebdomadaire "Place de la Toile" :
... nous avions parlé aussi de la mise en vente des droits
de diffusion du championnat de France de Ligue 1 pour les trois saisons à
venir. Douze lots sont proposés par la ligue nationale de football - un
lot, c'est un droit de diffusion ; par exemple le droit de diffuser les
dix meilleurs matches de la saison, ou celui de diffuser tous les matches d'un
seul club - bref, depuis cette semaine, on connaît certains des
candidats à ces lots. On s'attendait à ce que les opérateurs
de téléphonie mobile viennent compléter la liste des acquéreurs
traditionnels que sont les chaînes de télévision, mais la
surprise est venue du net : pour la première fois, un site internet
s'est porté acquéreur d'un des lots. Ce site, c'est
Dailymotion, le site français de partage de vidéos , et selon le
Figaro, Dailymotion serait candidat pour le lot 11, c'est à dire le
droit de diffuser un magazine vidéo à la demande, contenant des
extraits de matches.
Cette information est intéressante à
deux titres au moins : d'abord c'est l'entrée des acteurs du net
dans la diffusion de contenus sportifs. Pour l'instant c'est pour un contenu très
ciblé, un magazine qui résume les matches a-posteriori , ce n'est
pas le droit de diffuser les matches en direct - mais pourquoi pas, à
terme, l'obtention par un site du droit de diffuser ces matches en direct, ce
qui priverait les chaînes de télévision d'un contenu qui,
dans certains cas, comme celui de Canal+ notamment, est essentiel à la
stratégie de la chaîne
Deuxième raison pour laquelle
la candidature de Dailymotion est intéressante : c'est la volonté
de ce site de proposer des contenus édités et légaux.
Aujourd'hui, on trouve à peu près tout en matière de
football sur Dailymotion, des extraits de matches, des buts, tout cela mis en
ligne par des internautes, et tout cela offert gratuitement au visionnage de
tout le monde de manière totalement illégale. Dailymotion, qui a
fait son audience précisément sur des contenus pirates, fait
vraisemblablement des efforts pour s'inscrire dans la légalité.
Mais évidemment, ce n'est pas la morale qui est la raison de ce virage.
Derrière, il y a des raisons qui sont strictement économiques :
attirer des annonceurs et valoriser une audience absolument gigantesque et
mondiale. Reste à savoir si la ligue nationale de football répondra
positivement à la proposition de Dailymotion : cela dépendra
sans doute du montant. " 29
Comme on voit, on est loin de la bande de chouettes copains
qui partagent leurs vidéos... |
|
- Cette augmentation du volume commence à poser des problèmes
de documentation, d'indexation et de description. Lorsqu'il s'agissait de
quelques dizaines, voire quelques centaines de films, généralement
courts, la simple mémoire humaine de documentalistes qui connaissent
bien leur fond suffit. Lorsqu'on passe à des milliers de films et des
heures et des heures de projection, cela ne suffit plus. Or, le problème
est pour l'instant sans solution générale
- Enfin, pour qu'il y ait diffusion (et même conservation), il faut
que les systèmes aient une certaine pérennité ; or,
avec Vista et Mac OS-X, pour la première fois, il y a rupture : des
produits un tant soit peu complexes élaborés dans l'ancien système
d'exploitation ne tournent plus sous le nouveau. C'est Michel Lefebvre qui a
attiré mon attention sur ce point important, et je pense qu'il y
reviendra. Il ne sert à rien de numériser si le résultat
est illisible dans 5 ans... Ou peut-être que Linux...?
Pip Chodorov.- Si on en est à des milliers de films, les
industriels vont tout faire pour pouvoir continuer à lire les fonds
existants, même si c'est de mauvaise qualité
Michel Lefebvre.- C'est rassurant ! il faut être
optimiste...
Alain Montesse.- Dieu t'entende ! (rire )
3.2.- Portail ministériel
Alain Montesse.- En ce qui concerne les aspects juridiques,
administratifs, organisationnels, etc., un seul facteur nouveau à ma
connaissance : le projet de portail du cinéma expérimental
impulsé par le Ministère de la Culture. Une réunion générale
a été organisée le 18 juillet 2007, dans le
cadre du plan national de numérisation du patrimoine. Le projet du
Ministère est un projet de portail d'accès sur l'internet, donc
en format réduit et très compressé, qui aiguillerait
ensuite le visiteur vers les différents structures concernées. Il
n'est donc pas question directement de sauvegarde, de conservation ou
d'archivage, même si le Ministère, dans un premier temps,
subventionne diverses opérations de numérisation. Le mieux pour
le Ministère serait que " les structures se mettent
d'accord pour identifier parmi elles une «tête de réseau»...
". Cette réunion de juillet 2007 a depuis été
suivie par diverses réunions partielles ou contacts entre différents
acteurs, groupes ou institutions concernés.
Afin de faire le point,
j'ai contacté un certain nombre de gens : tous étaient
d'accord sur le principe pour venir cet après-midi, mais finalement, pas
grand-monde n'est venu.
Cette absence m'interpelle :o)))
Individuellement, tous avaient des raisons valables pour ne pas venir. Mais au
delà d'une éventuelle mauvaise conjoncture aujourd'hui, je me
demande s'il n'y aurait pas là quelque chose comme une régulation
statistique, comme une permanence structurelle. Comme disait Xenakis, les répétitions
statistiques " enlèvent le droit de parler de hasard... Les
martingales de Monte-Carlo et les théories de suicidés devraient
convaincre quiconque, une fois pour toutes " 30 " : quelles que soient les
raisons, éventuellement très bonnes, qui poussent des gens à
sauter du premier étage de la Tour Eiffel, il n'en demeure pas moins
que, jusqu'à ce que des mesures de prévention soient prises récemment,
ils étaient bon an mal an 3,6 en moyenne à avoir sauté.
De même, si je regarde dans le passé, la première
ParisFilmCoop date de 1966-1967, avec des gens comme O'Leary, Reffé,
Bouyxou..., le premier Collectif Jeune Cinéma date aussi de la fin des
années soixante - et depuis 40 ans, il n'y a jamais eu moyen
d'avoir une fédération. 31
Pip Chodorov.- Tous ces gens ont aussi autre chose à faire ;
ils travaillent dans des musées, des associations de distribution... Répondre
à cet appel du Ministère implique du travail supplémentaire,
il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe spécifiquement, ça ne fait
pas partie du boulot en soi, et c'est pour cela aussi qu'on n'a pas pu mettre
en place une vraie fédération qui se réunisse..
Les
groupes se réunissent parfois pour des tables rondes. Mais la numérisation
n'est pas leur activité principale, c'est du travail en plus; c'est
difficile de trouver le temps pour le faire. Il faut distribuer les films,
organiser les festivals.
Nous nous sommes vus tous ensemble une fois, à
cette réunion de juillet de l'an dernier, et le Ministère a
demandé à tous les groupes de se concerter, afin d'éviter
les doublons. Par exemple, les films de Patrick Bokanovski sont partout :
à l'INA, au Centre Pompidou, chez Light Cone, à la BNF... Qui va
en effectuer la numérisation ? étant donné que
Re:Voir l'a déjà fait.... Le Ministère dit " c'est
à vous de vous voir entre vous ". Mais on ne peut pas se
voir entre nous, parce que personne n'est libre, chacun a déjà
son propre emploi du temps, et ne va pas ajouter en plus la mission "numérisation"..
Alain Montesse.- En somme, les impératifs et les nécessités
à court terme empêchent de mener des actions qui pourtant stratégiquement
seraient plus intéressante
Pip Chodorov.- Exactement. Du moins pour faire cela en groupe, avec
une bonne vision de la chose. Par exemple, le Centre Pompidou est en train de
numériser tout son fond en SD. J'ai dit lors de la réunion qu'il
serait mieux de payer 40% de plus aujourd'hui, pour faire tout en HD ;
sinon, il va falloir revenir dans 3 ans pour tout refaire. La réponse a été
" le service financier ne va pas accepter cette augmentation ,
il préfère tout refaire dans 3 ans ". De toute façon,
c'est mieux en SD qu'en Flash, ce sera recompressé par la suite....
C'est dommage. Ils étaient prêts à numériser des
films rayés et passés, alors que Re:Voir l'avait déjà
fait à partir de copies neuves ou d'internégatifs. Heureusement,
on a pu trouver un arrangement pour qu'ils puissent travailler à partir
de nos sources, faites sous le contrôle du cinéaste lui-même.
Le Ministère demande que chaque groupe propose un budget pour la
numérisation et un projet pour le portail. Ce n'était pas très
clair. Avec le Collectif Jeune Cinéma (entre parenthèses :
Re:Voir ne fait pas partie des partenaires de ce projet ; c'est une société
commerciale, pas une association ; je parle en ce moment au nom du CJC),
nous nous sommes dit que nous allions proposer un projet de portail, parce que
nous savions qu'au Centre Pompidou ils n'ont pas le temps, et qu'il n'y avait
pas d'autre association qui ait des idées et les moyens de mener un tel
projet à bien. Moi, j'avais quelques idées, graphiques, de base
de données... Nous avons fourni au Ministère un budget et 3 pages
qui décrivent un portail possible, que le CJC pouvait prendre en charge,
en voyant chaque groupe, chaque structure, en centralisant les demandes, en vérifiant
tous les formats de film et les critères de bases de données, qui
doivent être harmonisés afin que le portail fonctionne. Nous
avions l'impression que c'est cela que demandait le Ministère. Mais ils
ont répondu «&nbs; on ne va pas faire cela tout de suite ».
Donc, c'était un peu confus, et la question du portail n'est pas encore à
l'ordre du jour.
- Alain Montesse.- Si, elle l'est quand même un peu 32 . Je relis la conclusion du
compte-rendu de la réunion de juillet dernier :
- " La MRT et la DAP soulignent qu'il
serait utile que les institutions intéressées se coordonnent pour
déposer un projet qui pourrait prendre deux formes :
Un projet
commun qui identifie dans chaque structure (musées, associations..) des
collections à numériser autour du thème du cinéma
expérimental
Un projet encore plus abouti : les structures se
mettent d'accord pour identifier parmi elles une "tête de réseau"
qui propose d'une part la numérisation de collections ( voir alinéa
ci-dessus) et d'autre part la création d'un portail qui permettrait par
une requête unique d'interroger les bases de données des
partenaires du réseau. Cette approche en réseau structuré
peut démarrer autour de deux ou trois institutions et intégrer
ultérieurement d'autres partenaires. Une attention particulière
sera dans ce cas apportée au respect des identités de chacun des
partenaires. "
- C'est bien ce que vous aviez fait ?
Pip Chodorov.- Nous avons essayé de prendre ce rôle,
mais en fait, le Ministère n'a jamais mis en oeuvre les moyens de
trouver une tête de réseau - parce qu'il n'y a pas de réseau.
Le ministère ne donne pas les moyens de créer ce réseau,
il demande juste à chacun « combien vous faut-il pour numériser
vos fonds », et c'est tout. Maintenant, chacun se met à
numériser son fond comme un malade parce qu'il y a des sous disponibles
- et c'est aussi un problème parce que le Ministère donne juste
la moitié de ce qu'il faut. Le Collectif Jeune Cinéma a besoin de
30.000, le Ministère nous en donne 15.000, et nous n'avons pas les
15.000 autres. Le Ministère est parti sur un projet auquel seules de
grosses structures comme le Centre Pompidou peuvent répondre - peut-être.
Et puis, il y a quelque chose qui m'étonne. Depuis des années, le
cinéma expérimental demande des subventions pour être
reconnu (même si la reconnaissance n'est peut-être pas la meilleure
chose pour le cinéma expérimental...). Tout à coup le
Ministère sort un projet qui concerne uniquement le cinéma expérimental.
Pas le narratif, pas le documentaire, pas les films de famille. Je trouve cela
très étonnant. Pourquoi le cinéma expérimental ?
Est-ce parce que la France peut mettre en avant des cinéastes dans ce
domaine de la culture française ? Je ne comprends pas très
bien...
Michel Lefebvre.- Il y a plusieurs logiques qui se télescopent.
Il y a la logique des réalisateurs, des producteurs, qui doivent trouver
leurs ressources financières, techniques, à court terme, voire à
très court terme : ces gens ont un problème de numérisation,
afin que les oeuvres soient diffusables le plus largement possible dans les réseaux
existants
Et puis il y a la logique des ministères, qui se disent "il
faut conserver une partie des oeuvres, avec des numérisations qui vont
exister longtemps" ; mais comme il y a un manque de moyens, on en
arrive à des montages dont l'on ne finance que la moitié - mais
cela se vérifie dans tous les projets financés, qu'ils soient
audiovisuels ou autres...
Et puis il y a peut-être une question de
fond : est-ce que ces oeuvres vont traverser une génération,
deux générations, etc.
Cela fait trois logiques qui se
superposent, et quand on passe d'une logique à l'autre, on a toutes
sortes d'incompréhension
Effectivement, on a pu constater, en
l'espace de 10 ans, que le format numérique, le mode de compression,
disparaît. Au bout de 10 ans, on se demande comment prolonger de 10
autres années... avec des dégradations physiques, de transcodage
Tout cela fait une situation extrêmement compliquée ; il est très
difficile de dire quel est le projet qui va pouvoir résister au temps
pendant plusieurs dizaines d'années. On travaille dans l'éphémère.
C'est vrai pour le cinéma expérimental c'est encore plus vrai
pour tous les produits interactifs, qui sont liés aux logiciels :
les logiciels ont besoin d'un système d'exploitation, quand le système
d'exploitation change, il n'est pas sûr que cela soit absolument
compatible...
Notre société (
http://www.acet.fr ) a de très bons
produits, des banques de connaissances, qui ont demandé pas loin d'un
million d'euros d'investissements, et nous les voyons mourir sans possibilité
de rattrapage. Nos produits sont compatibles Windows-Mac9. Ils ont cessé
d'être compatibles Mac quand on est passé au système X.
Maintenant on passe de Windows à Vista : les anciens Windows
travaillaient en 16 bits, il y avait encore une sorte de compatibilité ;
Vista travaille en 64 bits ; donc, tout ce qui tourne en 32 bits, terminé.
Heureusement, Vista ne marche pas encore très bien, il n'y a donc pas eu
une ruée sur ce système d'exploitation. Mais dès que Vista
sera au point, ce sera fini. Nos banques de connaissance ne seront plus
lisibles par quelque machine que ce soit, sauf peut-être dans un musée,
dans 20 ans et peut-être même avant. Elles ne seront plus
diffusables. On pourra peut-être les recopier, morceau par morceau...
Pip Chodorov.- En 1992, j'ai visité John Whitney, un cinéaste
expérimental qui faisait de la musique visuelle sur ordinateur, à
Los Angeles. Deux ans plus tard, il a voulu présenter son travail lors
d'un évènement, mais il avait fait son logiciel sur un 386, et
on était déjà passé au 486. Résultat, sa
musique n'était plus à la bonne vitesse.
Les choses qui
sortent aujourd'hui sont davantage compatibles qu'il y a 10 ans ; c'était
la galère, n'était-ce que pour faire passer un fichier word de
Mac à PC.
Michel Lefebvre.- Effectivement, entre Mac OS-X et Windows, il y a
des compatibilités, pas totales, mais les fabricants de logiciels se
sont arrangés pour qu'il y a ait des passages. Mais si on en arrive à
un processeur en 128 bits, ce seront les produits antérieurs, en bloc,
qui ne seront plus lisibles. D'ailleurs, il y aurait une proposition à
faire : mettre cela sous l'égide d'une grande institution mondiale,
l'UNESCO par exemple, qui garderait ce patrimoine. On peut très bien
imaginer un système d'exploitation, du genre Linux, suffisamment paramétrable
pour dans le futur s'adapter à tous les microprocesseurs, avec un système
de fichiers le moins compressé possible (parce que au fond, pourquoi
compresser, les machines et les mémoires ont maintenant une telle
puissance qu'on peut se poser la question, que ce n'est plus toujours nécessaire).
Cet ensemble constituerait une sorte d'étalon, auquel les systèmes
d'exploitation seraient obligés de se référer. On
pourrait comme cela conserver les oeuvres dans le temps. C'est un travail
collectif à faire.
Pip Chodorov.- Est-ce que le Ministère a choisi le cinéma
expérimental comme champ parce que c'est un champ de recherches sans
enjeu commercial, afin que, par la suite, ce qu'on apprend, nous, dans ce
travail-là, puisse s'appliquer ensuite à de plus gros films à
des industries ? Est-ce qu'ils utilisent le cinéma expérimental
comme cobaye ? Est-ce qu'ultérieurement, Gaumont par exemple va bénéficier
de ce même portail ? On est au début de ces questions de numérisation.
Pourquoi avoir choisi le cinéma expérimental
Michel Lefebvre.- Vous avez certainement en partie raison. Aux débuts
de la vidéo documentaire parlante, synchro, il y avait beaucoup de gens
qui passaient du temps, bénévolement, à résoudre
tous les problèmes techniques, à monter la bande vidéo au
scotch, les sociétés de matériel, Sony, Akaï, etc.,
finançaient des festivals... Cela a servi à jeter la base
industrielle des produits, jusqu'à ce qu'il y ait une base de machines,
de compétences, et alors on a vu arriver les machines industrielles
33 . Le cinéma expérimental
aussi est un secteur avec des gens passionnés qui y mettent beaucoup de
leur temps...
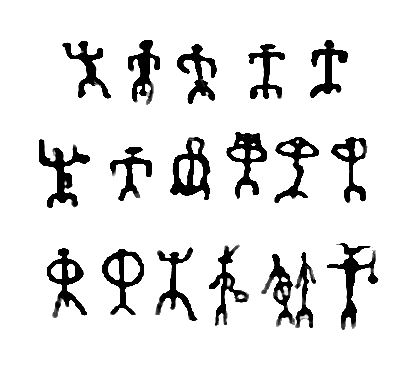
Robert Risler.- (arrivant du fond de la salle, et présentant le
dessin ci-contre) On trouve des dessins comme cela partout, en Egypte, dans
le monde entier... Ils ont 40.000 ans. Ils sont toujours parfaitement lisibles.
Donc, vous voyez, il y a déjà quelqu'un qui s'est préoccupé
de ces questions au niveau mondial...
Michel Lefebvre.- Il s'appelait Cro-magnon ! Et il n'avait pas
de droits d'auteur ! (rires)
Alain Montesse.- Je n'ai pas l'impression que le Ministère
ait choisi seulement le cinéma expérimental. Il y a tout un plan
de numérisation du patrimoine, décliné dans différentes
directions, avec des perspectives européennes. Certes, il est vrai que
le cinéma expérimental pose avec beaucoup d'acuité des
problèmes qui peuvent être plus facilement contournés par
le cinéma "normal". Mais je n'ai pas l'impression que les
grandes firmes aient tellement besoin de nous pour jouer les cobayes, les
explorateurs, les têtes brûlées... les caravanes
commerciales passeront sur nos os, on le sait.
L'intervention de Robert me
rappelle que je voulais dire aussi quelques mots de secteurs du cinéma
proches de l'expérimental, au moins par certains côtés, et
qui ont des problèmes du même ordre que les nôtres. Problèmes
techniques moins compliqués en ce qui concerne la numérisation
(ils ne mettent généralement pas en cause le médium et le
support - pour faire simple, disons qu'ils filment le plus fidèlement
possible la réalité telle qu'elle est), mais beaucoup plus lourds
en ce qui concerne le volume de données : c'est tout ce qui
concerne le cinéma ethnographique, le cinéma militant, le cinéma
scientifique. C'était souvent aussi du 16mm...
Pip Chodorov.- Le 16mm est devenu le moyen de tournage préféré
des petites productions, parce que la pellicule est bien meilleure : elle
peut capter jusqu'à 9 diaphs de différence dans la même
image, selon une courbe de sensibilité logarithmique ; la vidéo
en est loin, et suit une courbe de sensibilité linéaire. Le matériel
et la pellicule 16mm sont bien moins chers que le 35mm. C'est donc mieux de
tourner en 16, en super-16, et ensuite de numériser. Kodak sort toujours
de nouvelles émulsions, il vient d'en sortir une avec laquelle tu peux
charger la caméra en pleine lumière. Le fait d'ouvrir l'emballage
de la pellicule vierge déclenche une réaction chimique qui te
laisse 3 minutes avant que la pellicule soit sensible à la lumière.
Tu as donc le temps de charger la caméra et de la refermer.
Alain Montesse.- Le 16mm ne sert donc qu'au tournage.
Pip Chodorov Oui.
Michel Lefebvre.- Je voudrais faire une remarque sur la haute définition :
il ne me semble pas évident que l'on aille toujours vers la haute définition.
Dans les arts, et plus généralement dans tous les systèmes
d'expression, on constate qu'il y a d'abord une recherche du plus grand, du
plus énorme, de plus de détails, et puis, brusquement, c'est
abandonné. On admire la cathédrale de Paris, c'est une explosion
de détails, mais on ne pense plus à notre époque faire de
nouvelles cathédrales de Paris. On fait plutôt des bâtiments
très simples. Le Musée du quai Branly de Jean Nouvel se compose
de formes extrêmement simples. On voit ça partout. Dans la
vaisselle, on a eu au XIXème siècle une explosion, des soupières
avec plein de détails, d'ornements, etc., maintenant, rares sont les
gens qui pensent en ces termes, et on a des produits d'Habitat. Les draps brodés
sont maintenant des housses IKEA. On cherche le plus haut, le plus de détails,
et puis on redescend. Il y a des manifestations de pouvoir qui montent, et
puis c'est rejeté, on retombe vers des choses beaucoup plus simples. On
peut se demander si, dans le cinéma, on ne va pas assister à
cela. On a le cinémascope, la haute définition de télévision,
et puis tout à coup, qu'est-ce que l'on voit ? Les Youtube,
Dailymotion, les petites images qui attirent les jeunes. On peut se demander
si le grand écran de télévision n'aura pas qu'un temps. On
regardait la valeur d'une peinture au nombre de coups de pinceau par centimètre
carré : plus il y avait de coups de pinceau, plus la peinture était
chère. On regardait évidemment aussi l'allure générale,
bien sûr, mais on est maintenant revenu à quelque chose de
beaucoup plus schématique, du genre du dessin de Robert.
Robert Risler.- Au moyen-âge, les maisons qui entouraient la
cathédrale faisaient 1 étage au plus. Aujourd'hui, nous ne
voyons plus Notre-Dame comme on la voyait à l'époque, parce que
1) les gens qui sont entrés là-dedans ont vu pour
la première fois de la lumière colorée
2)
ont vu l'immensité de la maison de Dieu, qui devait par essence se
dissocier du bon peuple d'à côté. Vous parlez du musée,
mais vous oubliez qu'à côté, il y a les gratte-ciel de
bureaux ; il faut donc que l'ouvrage exceptionnel se différencie
autrement. Ce n'est pas tout à fait la courbe que vous évoquiez,
il y a d'autres facteurs.
Michel Lefebvre.- Je reconnais avoir été un peu schématique.
Mais les gratte-ciel avaient disparu, pendant un moment, et ils reviennent. Ce
sont les multinationales qui font les gratte-ciel; ce n'est pas du logement, ce
n'est pas la religion [sauf à considérer l'économisme
comme une religion, NDLC], c'est le pouvoir des multinationales qui se
manifeste ; on peut penser que cela aussi n'aura qu'un temps.
Pip Chodorov.- Les pyramides, c'étaient des pharaons, les
cathédrales, c'étaient des papes, et les tours, c'est des
corporations... On a eu ça, dans le cinéma expérimental.
Dans les années 50, les lettristes ont dit "le cinéma
est trop gros, trop obèse, trop riche, il y a la couleur, la musique, le
cinémascope, le western, la 3D et tout ce qu'on veut, et ce qu'il faut,
c'est détruire ce langage-là et créer un nouvel alphabet".
Et ils ont fait des films tout noirs, sans images du tout. Un autre exemple
est Peter Kubelka, qui a fait des films dans les années 50 avec des
images blanche, noire, blanche, noire - il n'y a plus d'image, il y a la bande,
la physicalité du cinéma pur. Et à partir de là
sont venus le cinéma structurel, matérialiste..
Michel Lefebvre.- Pourquoi revient-on à des formes simples ?
Parce qu'on recherche des invariants. Le cinéma ou la vidéo, ce
n'est pas de mettre des écrans de plus en plus grands avec un maximum de
détails. C'est réfléchir à partir du cadre, qui
limite le champ, de la couleur ou du noir et blanc, des formes... On revient à
des simplifications pour faire apparaître les invariants.
Alain Montesse.-J'ai un contre-exemple: la ULTRA HIGH DEFINITION (
http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_High_Definition_Video
). C'est un projet de vidéo en Ultra Haute Définition, propulsé
par la NHK, qui parle de faire du 7680*4320 pixels à 60 images par
seconde.
Que le but de la vidéo ne soit pas forcément de
faire un maximum de détails - cela dépend de quelle vidéo.
Il y a l'exemple de cet hôpital parisien, entièrement câblé
pour faire circuler les nombreuses images médicales de façon
immatérielle, mais les terminaux sont bien incapables de reproduire la
finesse de détails des plaques radio, scanners etc., et du coup, le
personnel paramédical continue à arpenter les couloirs et les
ascenseurs avec de grandes épreuves radio ou photographiques. Dans ce
cas précis, il s'agit de pousser la définition aussi loin que
possibl
Michel Lefebvre.- Là on est dans un cas différen
Alain Montesse.- Oui, mais si on remonte aux origines de
l'anatomie, médecins et artistes étaient très proches.
Cette configuration peut-elle revenir ? Si oui, les artistes toucheront à
cette Ultra Ultra Haute Définition 34
.
Pip Chodorov.- Dans le son: on a eu des vinyls, puis des cassettes
audio, des CD et finalement des mp3. Et chaque fois c'est moins cher, c'est
moins durable, et c'est de plus en plus populaire. Très concrètement,
c'est moins bien, tout le monde peut entendre la différence entre un
vinyl, un CD et un mp3. Les gens préfèrent de plus en plus
compact et de moins en moins bon. Donc, la qualité n'est pas un critère,
la qualité va à l'encontre de ce que les gens préfèrent.
Et en même temps, les grands industriels comme NHK cherchent à
avoir une résolution de plus en plus importante. Cela rejoint ce
qu'Alain disait au début : il faut faire des scans HD, parce que la
télé veut du HD, alors que chacun chez soi peut arriver à
faire du scan correct en SD. Et du coup, la télévision saute une étape,
pour dire " non non, vous n'êtes pas comme nous, nous sommes des
professionnels, il nous faut du HD". Donc les industries qui cherchent
des bénéfices vont chercher des résolutions que le peuple
ne cherche pas ; il n'en veut pas, il cherche le YouTube. Il y a donc deux
logiques : faire des bénéfices et avoir un gros
professionnalisme, et avoir le moins cher et le plus accessible tout de suite.
Michel Lefebvre.- Vous avez raison; mais il y a des industriels qui
cherchent le plus grand, le maximum de qualité, et d'autres industries
qui vont vers la stratégie aval, qui recherchent la démultiplication ;
les réussites économiques récentes sont plutôt du côté
de la grande diffusion.
Pip Chodorov.- C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec
le sport sur Dailymotion. C'est un réseau ouvert, les gens s'échangent
leurs vidéos, il y a du piratage partout, et du coup il n'y a pas de
commerce possible... sauf si on fait de la HD ! Je peux sortir un DVD d'un
film, il va être piraté partout ; mais si je le sors en HD,
il va être plus compliqué à pirater, et ce sont les
grosses chaînes qui vont me l'acheter... il est plus rentable de faire un
master HD.
Michel Lefebvre.- C'est votre intérêt, c'est l'intérêt
des créateurs en ce moment, oui. Mais cela ne va pas forcément
dans le sens de l'histoire. L'artisan en dorure avait intérêt à
travailler pour les rois, et il faisait du très beau travail. Le problème
c'est : où est le changement d'époque ? et qu'est-ce
qui succède à l'artisan ?
Pip Chodorov.- On ne fait pas forcément des films pour des
rois. Il y a des gens qui préfèrent être sur YouTube.
Maurice Lemaitre, le lettriste, a entendu parler d'une version piratée
de son film, il a dit "il faut stopper cela tout de suite, ils vont le
mettre sur l'internet, ce n'est pas possible" - alors que Jeff Scher,
un autre cinéaste, dit "mon idée du succès, c'est
que je sors de chez moi, et je trouve le DVD piraté de mes films à
Chinatown pour 5 dollars dans la rue ; là, je suis devenu un grand".
(rires).
Effectivement, le cinéma expérimental n'est
pas une industrie ; on fait des films avec les moyens du bord pour nous et
nos amis, éventuellement des festivals les montrent, on peut distribuer
quelques copies dans les différentes coopératives ; si cela
marche, c'est qu'il y a un petit public qui trouve cela intéressant ;
éventuellement cela mène à d'autres films, mais il n'y a
pas de commerce. Ma position est de diffuser des films expérimentaux en
VHS, en DVD, maintenant en BluRay ; on veut être diffusés, il
y a un public, il faut le trouver. Cela va dans une logique de commerce, avec
un contenu non-commercial.
Michel Lefebvre. Mais le cinéma expérimental n'est-il
pas l'amorce d'une méthode pour casser le cinéma traditionnel ?
Autrefois, il y avait le western, qui était très apprécié,
et puis Sergio Leone est venu, qui a repris certains aspects du cinéma
expérimental, et qui a réussi, avec Il était une fois
la révolution, à casser le western, quelque part la révolution
aussi, et une certaine forme de cinéma. Il y a eu une rupture. Le remake
de 3h10 pour Yuma qui vient de sortir refait du Sergio Leone, mais ce
n'est plus pareil. La génération actuelle n'aime plus le western.
N'y a-t-il pas, de temps en temps au cours de l'histoire, la nécessité
de casser la création artistique, intellectuelle, afin de laisser le
champ libre à de nouveaux créateurs, et redécouvrir des
choses ? N'y a-t-il pas nécessité à ce que la plupart
des oeuvres actuelles s'évanouissent ? Le cinéma expérimental
ouvre des portes, et en ferme d'autres.
Pip Chodorov.-Ce n'est pas de l'industrie, c'est de la poésie,
et on ne peut pas vivre de la poésie. Mais le cinéma ne se fait
pas avec un stylo et du papier, c'est très cher, on est dans une logique
de commerce industriel avec les intentions de la poésie. Certains vont
casser des choses, d'autres vont juste sortir dans le parc avec une caméra
super-8, il y a toutes sortes de directions. On peut dire que le cinéma
hollywoodien est centripète, parce que tous les films ont envie de se
ressembler. Si un film de science-fiction a marché à fond, on en
fait un autre. Alors que dans le cinéma expérimental, si quelque
chose est déjà fait, on ne va pas reprendre, on fait autre chose.
C'est centrifuge, parce qu'on a tendance à s'éloigner les uns des
autres; comme les peintres. Les tendances vont plus vers l'avant-garde, la
différence, et on ne se répète pas (ou du moins on ne
voudrait pas que ça se répète)...
Avec la HDTV, on
commence à dépasser la perception humaine. Au début du cinéma,
il y avait cinq images par seconde, tout de suite les frères Lumière
ont défini 16, puis ça a été 18, 24 avec le
parlant, et maintenant on veut arriver à 60. Mais au delà de 72
images par seconde, on ne perçoit plus le clignotement, le flicker.
Or, l'effet cinéma est plus fort quand il y a moins d'images par
seconde, parce que le cerveau participe à l'illusion du mouvement, et
l'illusion semble plus réelle 35
. Au début, le CD était prévu avec un échantillonnage
à 20000 Hz, on s'est très vite rendu compte que ça ne
suffisait pas pour les fréquences hautes, on est passé à
44000 et là, ça va 36
. Lorsqu'on scanne en 4k un photogramme de 35mm, chaque grain
argentique est représenté par une douzaine de pixels, et on peut
ultérieurement reporter sur pellicule sans perte. Faut-il qu'il y ait 30
pixels par grain ? Dans quel but veut-on capter de plus en plus de la réalité ?
Alain Montesse.- Pour le 35mm, de l'avis général, le
4k suffit ; mais pour le 70mm ? l'IMAX et le cinéma dynamique
Pip Chodorov.- Tu sais combien de films de cinéma expérimental
il y a en IMAX ? Il y en a un, de 30 secondes (de Stan Brakhage)..
Bruno Bourret.- Chez moi, je suis câblé (le câble,
pas l'ADSL), et quand je regarde des films le soir, c'est une catastrophe. Il y
a un tel taux de compression qu'on voit des artefacts partout. Entendre parler
de définitions pareilles me laisse rêveur, alors que déjà
on n'arrive pas à la qualité de la SD, en bout de chaîne en
diffusion sur le câble. Peut-être que du côté de la création
on fait de belles choses, mais en diffusion, on est en train de descendre.
Cela pose la question du mode de diffusion : est-ce qu'on travaille
seulement pour les gens qui vont s'acheter un lecteur de DVD haut de gamme ?.
Pip Chodorov.- Ils ne mettent pas le débit qu'il faut. Aux
heures de pointe, on a un espace de couleurs réduit, et de gros
macroblocs. J'avais le câble il y a quelques années, je me suis désabonné,
parce que ce n'était pas intéressant ; visuellement c'était
trop compressé. Je préférais la télévision
aux antennes en oreilles de lapin.
Michel Lefebvre.- Il y a deux compressions qui s'ajoutent . il
y a la compression initiale, du film sur DVD, et la compression pour la
transmission. Cela peut aboutir à des catastrophes. Le taux de
compression de diffusion varie selon les heures, et selon les heures, on a des
différences flagrante
Alain Montesse.- Et il s'en perd en chemin...
Pip Chodorov.- L'idée du BluRay, au départ, c'était
un graveur : on télécharge le film en HD, et ensuite on le
regarde. Là, ce serait différent, parce que le câble est en
temps réel : c'est comme si on essayait de faire passer beaucoup d'eau à
travers un tout petit tuyau. Pour la HD, il faut 5 fois plus de débit
qu'en SD. Donc télécharger puis graver peut prendre plus de temps
que le temps réel. Mais une fois que c'est gravé, on peut voir le
film avec le débit qu'il faut.
Alain Montesse.- Je reviens sur les questions de petits groupes de
gens passionnés et de systèmes disparus. Cela m'a rappelé
que dans le monde Amiga et dans le monde Atari, il y a 15-20 ans de cela, il y
avait quantité de petits groupes qui faisaient ce qu'ils appelaient des
démos. C'étaient de petits objets audiovisuels - surtout visuels
- qui duraient 2, 3, 4 minutes, qui poussaient la machine au maximum et
faisaient la démonstration des qualités de programmeurs et
d'artistes des gens du groupe. Il y avait des choses tout à fait
impressionnantes...
On peut maintenant émuler Atari et Amiga sur les
PC récents, qui sont suffisamment puissants pour pouvoir y faire tourner
un Atari ou un Amiga virtuel. Ces programmes d'émulation ne sont pas très
conviviaux, pas très pratiques à utiliser. Mais il y a peut-être
là une possibilité de solution pour les logiciels devenus
illisibles sur les nouveaux systèmes : on émulera Zindozs-98
sur Vista-2010... Mais on ne peut pas fonder une stratégie là-dessus.
Pip Chodorov Prenons l'histoire de L'Abominable : c'est une
association de cinéastes qui travaillent sur pellicule et qui trouvaient
que les labos professionnels ne pouvaient plus, ou ne voulaient plus faire ce
que ces cinéastes voulaient qu'ils fassent - par exemple faire un
sandwich avec plusieurs pellicules et faire un négatif à partir
de ça. Les labos disent "non, on ne peut pas passer ça
dans nos machines"... Donc, nous avons trouvé des machines,
dans des bennes, ou sur e-Bay, nous les avons achetées pour pas cher du
tout, nous les avons remises en marche, et maintenant nous pouvons faire des
films. Nous pouvons développer toutes sortes de pellicules, négatif,
inversible, positif, noir et blanc, etc., avec des machines sur lesquelles nous
avons la main. Nous pouvons faire des tirages contact, des tirages optiques,
nous avons toutes les sources de son, lecteur-enregistreur 16 mm, caméra-son
pour le son optique, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous-mêmes.
Il n'y a pas que ce seul labo , il y en a une dizaine comme cela en Europe, et
au Canada, en Corée du Sud, etc. Donc, les artistes commencent à
s'occuper eux-mêmes de la technique - des techniques dépassées :
nous tournons beaucoup en 16mm, mais les labos ne font pratiquement plus de
copies sonores. Pour trouver un labo qui fasse une copie 16 avec le son
optique, ce n'est pas évident. Mais nous, on peut le faire
Donc,
du côté des problèmes d'informatique, peut-être les
artistes qui faisaient des choses artistiques avec les anciens ordinateurs
prendront-ils en main le fait de préserver d'anciens ordinateurs. Mais
c'est intéressant de savoir que des artistes prennent en main le tirage,
les copies, éventuellement la fabrication de la pellicule 37 ... L'industrie ne le fait plus, et
nous avons encore envie de travailler avec nos caméras... Le super-8
sonore n'existe plus, mais les caméras super-8 existent; donc peut-être
quelqu'un va-t-il commencer à fabriquer du super-8 sonore pour faire
plaisir à nos caméras. Des technologies industrielles
disparaissent, et des artistes vont continuer..
Michel Lefebvre.- C'est peut-être ça, la solution ;
d'une façon paradoxale, pour conserver une oeuvre numérique, il
va falloir la filmer, parce qu'on est sûrs qu'on conservera la pellicule.
Quant aux appareils, si une roue dentée tombe en panne, on la refait ;
ça se refabrique ; un microprocesseur, non. Finalement, on ne
connaît pas la durée de vie d'un microprocesseur . est-ce
que, dans 20 ans, ils ne se décomposeront pas de l'intérieur ?
et c'est irréparable. On ne peut pas le refabriquer.
Pip Chodorov.- Ce n'est pas une pyramide
Michel Lefebvre.- Voila.
Yvonne Mignot-Lefebvre Pourquoi ne peut-on pas le refabriquer ?
Pip Chodorov Il faut une usine, avec 5000 personnes dedans,
habillées en blanc avec des gants...
Michel Lefebvre.- C'est tout un process industriel qui ne peut pas
se dissocier. Tandis qu'une roue dentée de projecteur, on peut toujours
la refaire. C'est moins fragile, finalement.
Pip Chodorov.- A L'Abominable, on fait cela. Nous avons acheté
un tour-fraiseuse. Il y a une galerie en Chine qui fait des projections 16mm,
et ce matin, j'attendais que quelqu'un passe avec un objectif chinois d'un diamètre
que nous ne connaissons pas ici, pour que je fasse une bague d'adaptation, et
insérer un grand-angle pour renvoyer en Chine. Et ça, c'est parce
que nous avons la machine-outil. En fait, ils pourraient très bien faire
cela en Chine, mais coïncidence, il se trouve que ça arrive
aujourd'hui
Alain Montesse.- Je reviens à une question d'ordre général
à propos du projet de portail du Ministère : comment peut-on
se sortir de cette difficulté à s'organiser ? Est-ce que
quelqu'un a déjà envisagé de faire un forum de discussion
sur le net, tout bêtement ?
Pip Chodorov.- Pas exactement; Je voulais qu'on fasse des réunions
régulières, qu'on se réunisse physiquement une fois par
mois... Un forum sur le web serait déjà quelque chose, oui...
sauf que ce serait une discussion interne, une mailing list..
Alain Montesse.- Je ne pensais pas à une liste, mais à
un vrai forum, où les messages restent, sont plus ou moins visibles de
l'extérieur, où les discussions sont structurées, par thèmes,
par fils...
Pip Chodorov J'ai demandé à la personne du Centre
Pompidou quels sont les critères de compression qu'ils appliquent pour
leurs numérisations ; il me l'a dit. J'ai demandé la même
chose à Emmanuel Lefrant de Light Cone, et il me l'a dit. Du coup, au
Collectif Jeune Cinéma, nous avons fait notre projet pour le Ministère
en utilisant ces critères ; en disant "nous allons faire
comme eux". Parce que si quelqu'un commence à numériser
10000 films, même s'il n'a pas pris le meilleur format, il faut
peut-être s'aligner. On ne va pas faire du Flash alors qu'il faut du
MPEG-2, ou vice-versa. C'est c..., mais c'est comme ça.
Donc déjà
d'une manière très très pratique, ces discussions se font.
Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de discussions à avoir : mais
c'est vrai que les bases de données vont demander qu'une cohérence
soit donnée. Pour l'indexation par exemple d'un film de Bokanovski, je
vais avoir des mots-clés, comme "miroir déformant", "musique
concrète", "surréalisme", etc. Il faut que ces
mots-clé soient compatibles avec d'autres mots-clés que d'autres
gens ont défini, afin que quand quelqu'un fait une recherche, cette
recherche soit fructueuse.
- Alain Montesse.- Si je regarde les chiffres donnés lors de
la réunion de juillet dernier, je lis :
- Light Cone : 3000 oeuvres
Heure Exquise ! :
300 vidéos numérisées, pas de précisions sur leur
stock total
Re:Voir : 800 court-métrages
Collectif Jeune Cinéma
: 700 heures
Forum des Images : plus de 5000 titres, 3000 heures....
- Quant à l'INA, n'en parlons pas. La documentation est un problème
de fond, qu'on a un peu tendance à oublier tellement il est énorme.
Pip Chodorov.- Brakhage a fait 350 films, il y a tout à
faire, même à restaurer les négatifs. Dominique Lange a
fait beaucoup de films en Super-8, des heures et des heures : tu gardes ça
chez toi, tu ne vas pas tout numériser..
Dominique Lange.- Si je reprends ta comparaison avec les tableaux,
c'est comme si, une fois qu'on a fait les photocopies, on jette tout le
Louvre...
3.3.- E-30
Alain Montesse.- Pour conclure, je vais m'offrir un petit plaisir -
il faut quand même qu'il y a quelques images dans cette séance.
C'est mon tout premier film, c'était en 8mm, il est resté à
l'état d'original et dans un assez sale état, j'ai donc entrepris
de le restaurer - image par image car comme vous allez voir, il n'est pas
possible de faire tourner un logiciel de restauration automatique là-dessus.
Je n'en ai encore fait que la première partie - les 2/5 - , ce n'est pas
tout à fait au point, mais c'est déjà présentable.
C'était à Bordeaux, en mars-avril 1968 ; ça
s'intitulait E-30 (pour expérimental 30 mètres - au final ça
en a fait davantage), et aujourd'hui, en le restaurant, je me suis dit que c'était
un peu mon homme à la caméra à moi. Et donc, 40 ans
après, je lui ai trouvé un sous-titre : Le jeune homme
avec la petite caméra .
A la prochaine !
La séance se termine par la projection de la première
partie de E-30 (6' et quelques secondes).
La discussion se continue off
record et à bâtons rompus à la terrasse d'un café
de la place Jussieu. On envisage entre autres choses les axes de discussion d'un
éventuel forum, la construction d'une machine artisanale de numérisation
du 16mm en HD...
... à suivre.
1 L'effet "bullett
time" est la reprise, sur un mode plus industriel, des bricolages mis au
point par Michel Gondry dans différentes pubs, à commencer par la
pub Smirnoff de 1996. Cet effet, connu aussi sous le nom de "temps gelé"
ou de "temps suspendu", est un mélange de la technique bien
antérieure et connue en architecture de la stéréophotogrammétrie
(prise de vue d'un même objet sous différents angles, afin
d'effectuer des mesures) et de la décomposition du mouvement à la
Muybridge-Marey-Demenyï-etc. Le mélange était nouveau, les
ingrédients étaient anciens, cf.
http://escience.anu.edu.au/lecture/cg/CGIntroduction/Data/matrix_bullettimewalkthru1.mov
2 Voir par
exemple la rétrospective de la cinémathèque de Dole il y a
quelques années ( http://www.dole.org/mediatheque
- elle n'est plus en ligne, mais elle y reviendra) ; ou celle de
Christian Lebrat au Forum des Images à Paris durant l'été
2005 ; ou celle de de Christian Lebrat et Nicole Brenez duranr l'année
2000 à la Cinémathèque française. Voir aussi
http://www.braquage.org/Guide/VADE.html
3
Cf. http://www.mediamatic.net/article-9121-en.html
; http://www.ifilm.com/player/?ifilmId=2664111
4 La
masse critique, auto-histoire de la Hamburger Filmkooperative, diffusée
sur ARTE le 10/2/2000 à 0h30 ; cf. :
http://www.diethede.de/diethede/films/detail/masse.html
5 Cf. The
Differences Between Film & Digital Vid (
http://www.kodak.com/US/en/motion/news/wallis.shtml
), ainsi que
http://www.cinematography.net/Pages%20GB/Telecine%20type%20overview.htm
, etc.
6 Il a aussi
semble-t-il existé un système allemand, dénommé
Toccata, dont je ne retrouve plus trace que dans Culture-Pub, M6,
13/2/1994.
7
Cf. http://reperages-rhone-alpes.com/
, http://www.transferts-numeriques.com/telecinema.html
;
http://www.dvdinfinity.com.au/index_fr.htm
8 On
trouvera d'autres précisions en http://www.son-video.com/Conseil/Video/IntroTVHD.html
http://pages.videotron.com/danjean/HDTV.html
http://www.expandore.com/product/Sony/Proav/model/HDV/QNA.htm
..
http://www.repaire.net/site/montage/montage_HDV/montage_hdv_retour_experience.php
http://www.swisseffects.ch/franzoesisch/e_scan/pages/e_scan_mpict2.htm
9
Vidéo entrelacée :
http://www.labdv.com/leon-lab/video/interlace.htm
;
Qu'est-ce que l'on entend par vidéo progressive ? :
http://boostercorp.com/article/articleview/24/1/2/index.htm
10
Pour plus d'informations :
http://www.repaire.net/site/sfx/ae/9.php
http://www.dvdanime.net/articleview.php?id=44#pulldown
11
Cf.
http://www.centrimage.com/page/resto%20num%20doc%20audio.htm
http://graphics.cs.msu.su/en/research/denoising/index.html
http://www.compression.ru/video/denoising/index_en.html
http://compression.ru/video/old_film_recover/index_en.html
http://www.imagineersystems.com/support/mokey/tutorials
http://www.genarts.com/sapphire-ae.html
12
Sur la projection 2k, cf.
http://www.barco.com/digitalcinema/en/products/DLPCinemaprojectors.asp
13
Cf. http://www.lowave.com/releases.php?lang=french
http://lowave.com/?language=FR§ion=shop&display=focus&focus_ref=LOWAVE010DVD
http://www.doriane-films.com/pages/dvd_experiemental/cat_experime.htm
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/cultureplus/fiche.php?diffusion_id=29882
14
Cf. http://www.cinedoc.org
; cf. Animeland n°113 (
http://213.186.42.207/?rub=articles&id=689
) ;
http://www.dvdanime.net/critiqueview.php?id_critique=1541
15 Evidemment,
le développement ultre-rapide des sites de partage vidéo
(YouYube, Dailymotion...) a depuis modifié sensiblement la situation et
entraîné une diffusion quantitativement bien plus importante...
avec des problèmes de droits, de qualité, etc, spécifiques :o)(note
ajoutée fin 2007) .
16
Cf. http://www.re-voir.com
17 Cf.
The Differences Between Film & Digital Vid (
http://www.kodak.com/US/en/motion/news/wallis.shtml
)
18
Cf.
http://palimpsest.stanford.edu/byauth/vitale/digital-projection/
19
Cf.
http://www.clarkvision.com/imagedetail/eye-resolution.html
20
Cf. http://www.blu-ray.com/faq/
21
Cf. http://www.cd-writer.com/blu_ray_faq.html
22
Cf. http://www.eyedesignbook.com/ch3/eyech3-i.html
23
Cf.
http://www.clarkvision.com/imagedetail/eye-resolution.html
24
Voir aussi
http://www.nmartproject.net/agricola/mpc/volume6/urban.html
; un autre site Flash s'intitule, significativement, " mort
de la télé " :
http://www.mortadellatv.com/online.html
25
Cf.
http://www.crdp.ac-creteil.fr/artecole/de-visu/v-jay/welcome.htm
; http://homepage.mac.com/etrerk/readdvdsample/readmov.html
...
26
Cf. http://www.quidam.fr
27
Cf.
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/affinites/fiche.php?diffusion_id=50696
28
Cf.
http://www.objectif-cinema.com/article.php3?id_article=3123&artsuite=0
29
Cf.
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/place_toile/fiche.php?diffusion_id=59397
(la reécoute n'est probablement plus possible)
30 "Eléments
sur les procédés probabilistes (stochastiques) de composition
musicale", Kéleüt , L'arche, Paris, 1994 (ISBN
2-85181-333-1.
31 On
pourrait remonter au colloque de Lyon en 1978. Patrice Kirchofer en rendit
compte sous le titre éloquent d Le merdier. Le problème
(manque d'accord dans le milieu) dure depuis longtemps. Pour plus amples
informations, cf. par exemple http://emedia.free.fr/exp/exp3.html
, ainsi que les autres fichiers du répertoire
http://emedia.free.fr/exp/ .
32 Dans sa
lettre d'avril 2008, Heure Exquise !, qui est plutôt vidéo
que cinéma expérimental, se déclare " très
inquiet [e] pour le développement de [ses] activités
", " toujours en colère, mobilisée et vigilante
" ( http://www.exquise.org/lettredinfo/avril2008/avril2008.htm
).
33 . Dans
la nuit du 19 septembre 2006, France Culture diffusa une histoire des débuts
de cette vidéo indépendante :
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/surpris/fiche.php?diffusion_id=45130
34 Cela se
fait peut-être déjà en photographie, cf. les images
d'Andreas Gursky (
http://www.moma.org/exhibitions/2001/gursky/gursky2.html
...)
35 Objection
éventuelle : le cinéma dynamique fonctionne à 60 images
par seconde, et l'illusion de réalité y est très forte. Il
y a probablement une différence entre ce que Pip appelle l'effet cinéma
et l'illusion de réalité
36 NDLC :
Alain Montesse se souvient fort bien d'une discussion avec Luc Ferrari, à
la cantine des MANCA (Musiques Actuelles Nice Côte-d'Azur), en 1982, à
propos du fait que tous les CD nous semblaient sonner un peu de la même
façon : échantillonner à 44100 Hz implique qu'un son à
22000 Hz est représenté par une onde carrée ; même
si l'on n'entend en général pas directement ces bas ultrasons, il
nous semblait certain que cela était pour beaucoup dans l'aspect
uniformément clinquant du son des CD.
37
On trouvera en
http://www.flickr.com/photos/dark_orange/sets/72157603226919391/
les éléments d'une machine artisanale à fabriquer de la
pellicule.
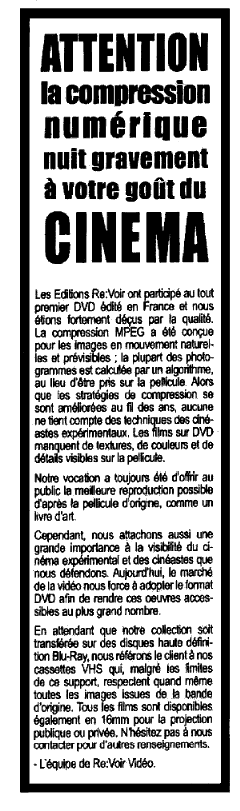 Autre exemple, notre travail pour les éditions Re:voir de Pip Chodorov
- qui met dans tous ses DVDs (c'est moi qui les fais, j'y mets toute mon
attention et tout mon coeur) ce message qui ressemble un peu à ce qu'on
voit sur les paquets de cigarettes :
Autre exemple, notre travail pour les éditions Re:voir de Pip Chodorov
- qui met dans tous ses DVDs (c'est moi qui les fais, j'y mets toute mon
attention et tout mon coeur) ce message qui ressemble un peu à ce qu'on
voit sur les paquets de cigarettes :